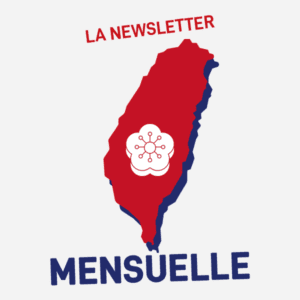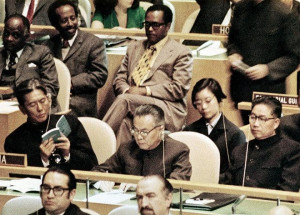Le « manosphère » – cet ensemble de communautés d’hommes en ligne prônant une idéologie masculiniste – gagne du terrain en Asie, y compris à Taïwan. Sur des forums anonymes et des réseaux sociaux, des groupes d’hommes expriment un rejet du féminisme et de la société moderne, se présentant parfois comme les « laissés-pour-compte » du progrès social. Ce phénomène prend des formes variées : des incels (célibataires involontaires nourrissant une rancœur envers les femmes) aux adeptes du MGTOW (« Men Going Their Own Way », qui prônent la vie sans attaches féminines), en passant par les pick-up artists (gourous de la séduction) et les chantres autoproclamés des « mâles alpha ». Tous réagissent à leur manière aux bouleversements des rôles de genre et à l’émancipation féminine dans la région.
Incels, MGTOW, « alphas » : différents visages du masculinisme
Il n’existe pas de profil type d’homme attiré par ces mouvements masculinistes : ils touchent toutes les générations, toutes les classes sociales et tous les niveaux d’instruction, car les raisons d’adhésion sont multiples : haine des femmes, sentiment de déclassement, difficulté à trouver sa place, manque de confiance en soi, peur de l’émancipation féminine ou rejet des normes égalitaires.
Le terme incel (pour involuntary celibate, « célibataire involontaire ») désigne des hommes – le plus souvent jeunes – qui se définissent par leur impossibilité à trouver une partenaire sexuelle et affective. Sur des forums en ligne, ils développent une vision du monde profondément misogyne, blâmant les femmes pour leurs déboires amoureux. Ce sous-courant, né en Amérique du Nord, a connu des dérives violentes dans certains pays : plusieurs attaques meurtrières ont été revendiquées par des incels se posant en « victimes » de femmes qui les auraient rejetés. En Asie également, des préoccupations émergent quant à une possible radicalisation de ces communautés en ligne. Dans ces espaces virtuels, on retrouve un jargon codifié opposant par exemple les Chads (caricature d’hommes dominants et attirants) aux Stacys (femmes jugées superficielles ne s’intéressant qu’aux Chads) – signe d’un univers parallèle nourri de ressentiment.
MGTOW – Men Going Their Own Way ou « les hommes qui tracent leur propre voie » – incarne une autre réponse à ce malaise masculin. Les adeptes du MGTOW prônent une séparation quasi-totale d’avec la gent féminine. Plutôt que de chercher la confrontation ou la revanche, ils choisissent le retrait : refuser le mariage, éviter les relations amoureuses et parfois même toute interaction sociale avec des femmes. Certains vont jusqu’à pratiquer le « mode moine », c’est-à-dire une abstinence sexuelle volontaire complète. Cette tendance, née dans les recoins d’Internet il y a une quinzaine d’années, est devenue suffisamment visible pour que même la presse généraliste s’y intéresse. Elle se nourrit de l’idée que la société actuelle serait « gynocentrique », dominée par les intérêts féminins, au détriment des hommes. Le MGTOW propose donc aux hommes déçus ou frustrés de « reprendre le contrôle » de leur vie en s’affranchissant des attentes liées aux femmes.
D’autres courants préfèrent affronter la révolution féministe sur son propre terrain. Les pick-up artists (PUA), ou artistes de la drague, se présentent comme des coaches enseignant l’art de séduire par diverses techniques psychologiques. Popularisé dans les années 2000 en Occident, le mouvement PUA a peu à peu dérivé vers des méthodes manipulatrices et sexistes visant à « jouer les femmes pour obtenir du sexe».
En Asie, ces pratiques ont également essaimé : en Chine, le sigle PUA est même entré dans le langage courant pour dénoncer les manipulateurs affectifs. À l’origine conçu pour aider des hommes timides à gagner en assurance, le coaching de séduction est souvent critiqué aujourd’hui pour sa vision de la femme comme un « objectif » à conquérir. Quant aux partisans de la philosophie du « mâle alpha », ils prônent un retour à une masculinité stéréotypée, faite de domination, d’assertivité et de réussite matérielle. Des influenceurs comme Andrew Tate – ancien kickboxeur américano-britannique devenu gourou en ligne – ont popularisé cette figure de l’alpha empreinte de misogynie, auprès de millions de jeunes hommes à travers le monde. Sous couvert de self-help (développement personnel), ces discours encouragent une vision ultra-compétitive des rapports de genre, où l’homme doit reprendre sa place de dominant naturel et considère l’égalité femmes-hommes comme une menace.
Enfin, une autre facette plus singulière de cette nébuleuse est celle des « aventuriers masculins ». Le terme recouvre des profils variés d’hommes qui choisissent l’évasion et l’aventure individuelle comme réponse aux pressions sociales. Cela peut aller du jeune qui s’expatrie ou voyage en solitaire en se proclamant digital nomad, au « passport bro » occidental cherchant une compagne à l’étranger plus « traditionnelle ». En Asie, où la mondialisation des cultures est très forte, on voit émerger des vlogueurs et blogueurs vantant un style de vie nomade, sportif, affranchi des conventions familiales. Sans revendiquer ouvertement la misogynie, cette posture valorise l’individualisme masculin comme alternative à un modèle de vie jugé féminisé. Elle peut ainsi faire écho aux idées MGTOW (rejet des engagements familiaux) ou PUA (multiplication des conquêtes lors de voyages exotiques), tout en soignant une image positive d’homme libre et aventurier. Ce courant est plus diffus, mais participe lui aussi à la remise en cause des schémas traditionnels de couple et de famille.
En réaction aux transformations sociales et au féminisme
Si ces mouvements et sous-cultures prennent de l’ampleur, c’est en grande partie en réaction aux profondes transformations sociales des dernières décennies en Asie. Partout sur le continent, la condition féminine a évolué : accès accru à l’éducation, insertion professionnelle, recul de l’âge du mariage et des naissances, sans compter l’essor de mouvements féministes locaux. Taïwan, est aujourd’hui classé premier en Asie en matière d’égalité des sexes selon le rapport mondial sur la parité. Le pays a été pionnier en Asie sur des avancées sociétales majeures, de la dépénalisation de l’adultère à la légalisation du mariage homosexuel. Dans l’ensemble de l’Asie de l’Est, les jeunes femmes d’aujourd’hui sont souvent plus diplômées que les hommes de la même génération et aspirent à davantage d’indépendance économique et personnelle.
Ces progrès s’accompagnent toutefois d’un retour de bâton de la part d’une fraction de la gent masculine. En Corée du Sud, par exemple, près de 70 % des hommes dans la vingtaine estiment être victimes de discriminations liées à leur genre d’après un sondage de 2019. Un ressentiment alimenté par le service militaire obligatoire (réservé aux hommes dans ce pays), la concurrence sur le marché du travail et l’impression que les femmes bénéficieraient de privilèges nouveaux. « Depuis les années 2010, la société devient plus discriminatoire à l’égard des hommes que des femmes », affirme ainsi un trentenaire sud-coréen cité par la presse, qui dit avoir eu le déclic en voyant des militantes se moquer du physique des hommes en ligne. Ce sentiment de déclassement face aux femmes est également observé au Japon et en Chine, sur fond de stagnation économique et de changements démographiques. En Chine, les autorités s’inquiètent du désengagement de nombreux jeunes hommes (phénomènes des « sanglieristes » ou du lying flat), tandis que dans le même temps des voix masculines conservatrices fustigent les revendications des femmes.
Les mouvements masculinistes prospèrent précisément dans ce climat de crise de la masculinité identifié par les sociologues. « Nous vivons dans un monde instable, et les hommes, comme les autres, font face à de nombreux problèmes. Ils se sentent aliénés » note Jacob Johanssen, chercheur britannique, pour expliquer l’attrait de la manosphère en période de changement. La réussite féminine et les discours égalitaires peuvent être vécus par certains hommes comme un déclassement ou une remise en cause de leur identité. Les forums masculinistes servent alors de soupape : on y canalise ses frustrations, on y trouve d’autres boucs émissaires que soi-même. Dans ces espaces virtuels, les griefs personnels se transforment en une idéologie du genre, avec ses théories (parfois conspirationnistes) affirmant que le féminisme aurait « détruit la société traditionnelle » ou instauré un biais anti-hommes systémique. Les chercheurs établissent un lien entre cette rancœur genrée et la montée d’un conservatisme plus large, souvent associé à la droite populiste. En effet, le rejet du « politiquement correct » et de la diversité va souvent de pair avec le rejet du féminisme dans ces milieux.
Taïwan : réseaux sociaux et figures locales du masculinisme
Bien que Taïwan soit l’une des sociétés asiatiques les plus progressistes en matière de parité, elle n’échappe pas à la diffusion de ces idées. Sur l’île, l’espace en ligne sert de principal vecteur au masculinisme. Le forum PTT – très populaire auprès des Taïwanais pour discuter anonymement de tous les sujets – a ainsi vu émerger en 2015 un véritable culte misogyne baptisé « mère des porcs » (mu zhu jiao). Ce terme insultant, équivalent de « truie », a été utilisé pour conspuer des femmes jugées indésirables ou émancipées. En l’espace d’un an, plus de 13 000 posts ou commentaires sur PTT comportaient le mot mûzhū (« truie ») pour dénigrer les femmes. Les adeptes de ce sombre humour récitaient des slogans hostiles tels que « les truies pleurent la nuit » ou « sale truie va crever », érigeant toute femme ainsi étiquetée en ennemie collective.
Ce phénomène de harcèlement de masse, analysé par des chercheurs taïwanais, révèle une sous-culture misogyne bien implantée sur les forums locaux. Un simple fait divers ou une vidéo virale mettant en scène une femme peut déchaîner des flots de commentaires haineux de la part de ces « soldats » du sexisme ordinaire, toujours prompts à employer le terme « Tai mei » ou « Taiwanese girl » sur un ton péjoratif pour délégitimer les Taïwanaises.
Sur les réseaux sociaux grand public, le discours est souvent plus édulcoré, mais des influenceurs taïwanais relaient, parfois sans le savoir, les éléments de langage de la manosphère. YouTube compte par exemple des chaînes en chinois dédiées au « développement personnel masculin », qui abordent frontalement les thématiques de la séduction, du rapport aux femmes ou du rôle de l’homme moderne. L’une d’elles, AB de l’étrange monde (AB的異想世界), suivie par des dizaines de milliers d’abonnés, propose des vidéos aux titres évocateurs comme « La vérité inavouée sur les incels » ou « Pourquoi le féminisme va trop loin ». Sous couvert de coacher ses auditeurs pour être la meilleure version d’eux-mêmes, ce youtubeur aborde la théorie de la « pilule rouge » popularisée par la communauté masculiniste, critique le MeToo ou explique comment regagner confiance face à des femmes perçues comme exigeantes.
Sur TikTok, réseau prisé des plus jeunes, circulent également des extraits de vidéos d’influenceurs occidentaux comme Andrew Tate ou d’autres gourous de la virilité, traduits en mandarin. Ces clips, souvent sortis de leur contexte, véhiculent des messages simplistes – « un homme vrai doit contrôler sa femme », « les femmes d’aujourd’hui n’apprécient plus les gentils garçons »… (comme si le fait d’être gentil envers les femmes impliquait au pire une obligation au mieux une contrepartie de réciprocité qui inclurait une récompense (sexe, relation…)) – qui peuvent trouver un écho chez des adolescents en quête de repères.
Des figures locales commencent aussi à émerger. Ainsi, certains entraîneurs de drague taïwanais se sont fait connaître sur Internet en affichant leur réussite avec des femmes et en vendant des formations. Des entreprises proposent désormais des cours de séduction payants à Taipei, combinant les recettes des coachs occidentaux et chinois adaptées à la culture taïwanaise, afin d’« améliorer vos interactions avec la gent féminine en toutes circonstances ».
Sur Facebook ou Instagram, des pages aux noms évocateurs – du type Dating Guru Taiwan ou Charm Society – attirent des milliers de membres en promettant aux hommes conseils vestimentaires, techniques d’approche et astuces pour accroître leur « valeur sur le marché amoureux ». Si beaucoup de ces contenus se présentent comme des conseils innocents pour timides en mal d’amour, ils véhiculent en creux une image de la femme réduite à un enjeu de conquête. Les échecs sentimentaux ou sexuels masculins y sont imputés à une inaptitude qu’il faudrait corriger par des trucs et non à interroger dans le cadre plus large de l’égalité des sexes.
En parallèle, le discours anti-féministe s’est banalisé dans certaines sphères taïwanaises en ligne. Sur des forums comme PTT ou Dcard, on voit revenir des expressions comme « 女權自助餐 » (« le buffet du féminisme »), pour accuser les femmes de ne vouloir que les avantages de l’égalité sans en accepter les responsabilités. Des vidéos locales tournées dans la rue, où un interviewer demande à des passantes si « les hommes devraient toujours payer l’addition » ou si « elles pourraient aimer un homme au salaire inférieur au leur », alimentent des débats enflammés en ligne. Bien souvent, les commentaires sous ces posts dégénèrent en règlements de comptes entre jeunes hommes et jeunes femmes, reflétant une tension latente sur les rôles de chacun. Taïwan n’est pas hermétique aux tendances qui parcourent ses voisins : le mouvement anti-féministe sud-coréen et ses mèmes (comme le geste moqueur de pincer le pouce et l’index pour dénigrer la taille supposée du sexe masculin) ont trouvé écho sur l’internet taïwanais, tout comme les polémiques misogynes du web chinois (par exemple le torrent d’insultes contre la stand-upeuse Yang Li qui avait osé plaisanter sur les hommes).
Jeunes hommes sous influence et malaise social
Le succès de ces discours masculinistes auprès d’une partie de la jeunesse masculine taïwanaise et asiatique s’explique par plusieurs facteurs de contexte socio-économique. D’une part, beaucoup de jeunes hommes se disent en proie à une pression sociale intense : obligation de réussir financièrement dans des économies compétitives, difficulté à accéder à la propriété ou à une carrière stable, ce qui les rend moins confiants pour s’engager dans une relation sérieuse. À Taïwan, les salaires stagnent depuis des années tandis que le coût de la vie augmente, conduisant certains à estimer qu’« ils n’en ont plus pour leur argent » dans le contrat social traditionnel où l’homme devait pourvoir aux besoins du foyer. D’autre part, les jeunes femmes d’aujourd’hui ont des attentes différentes vis-à-vis du couple – moins de mariages arrangés, plus de partenariats égalitaires, ou tout simplement le choix assumé de rester célibataire plus longtemps. Cela crée chez certains hommes un sentiment de décalage ou de rejet, surtout s’ils adhèrent encore à l’idée que l’homme doit être le pilier principal du ménage.
Les communautés masculinistes exploitent ce mal-être en proposant une narration alternative. Plutôt que de remettre en question le modèle masculin traditionnel ou d’affronter ses propres faiblesses, l’adepte du discours red pill (pilule rouge, en référence au film Matrix)) est encouragé à blâmer un système dans lequel les femmes auraient pris le pouvoir. Ce discours agit comme un exutoire psychologique. Sur YouTube, comme le souligne le chercheur Joshua Thorburn, les contenus de la manosphère fonctionnent souvent à la manière de groupes d’entraide pour hommes : on y discute librement de mal-être, de solitude, de doutes – des sujets encore trop souvent tabous pour la gent masculine.
En ce sens, ces espaces répondent à un vrai besoin d’écoute. Mais dans le même temps, la frontière entre soutien émotionnel et bascule vers la haine est mince. Un jeune homme qui cherche innocemment des conseils pour surmonter sa timidité peut, de fil en aiguille, être exposé à des contenus de plus en plus radicaux. Les algorithmes des réseaux sociaux jouent un rôle aggravant : en suggérant toujours plus de vidéos sur un thème qui attire l’attention, ils peuvent mener un garçon en manque de repères vers des créneaux extrêmes sans qu’il en ait conscience. Ainsi, un adolescent taïwanais suivant des tutos de musculation ou de « développement de la confiance en soi » pourra se voir recommander des podcasts d’influenceurs discutant de la prétendue hypocrisie des femmes modernes ou de l’idée que « les hommes et les femmes ne seront jamais égaux ».
Le risque, soulignent les experts, est une radicalisation insidieuse. À force de baigner dans une bulle informationnelle où tous les torts sont imputés aux femmes ou au féminisme, certains hommes développent une vision déformée de la réalité. Ils peuvent adopter une posture victimaire permanente (« tout est contre nous, hommes ») ou, au contraire, une agressivité revancharde. Cette diffusion d’idéologies antifemmes a déjà eu des conséquences concrètes ailleurs dans le monde. Au Canada et aux États-Unis, des crimes violents ont été perpétrés par des jeunes radicalisés en ligne sur des forums incels. En Asie, on n’en est pas là, mais la montée du harcèlement en ligne est palpable : en Corée, des personnalités féminines ou des chanteuses de K-pop ont été acculées au suicide sous la haine sexiste en ligne ; en Chine, des féministes sont menacées de mort pour avoir simplement dénoncé le machisme quotidien.
À Taïwan, le climat reste moins polarisé, mais l’augmentation des propos haineux sur Internet inquiète les associations. Celles-ci rappellent que la misogynie banalisée prépare le terreau des violences : injures, cyberintimidation, et possiblement violences domestiques ou agressions, si ces idées continuent à se répandre sans contradicteur.
Un défi de société sobrement documenté
Il serait faux de caricaturer l’ensemble des hommes taïwanais ou asiatiques comme acquis à ces idéologies masculinistes – la majorité d’entre eux ne se reconnaissent pas dans ces excès. Néanmoins, la visibilité croissante de ces mouvements interpelle. Elle témoigne d’un malaise masculin qui mérite d’être entendu, tout en posant la question de la lutte contre les dérives sexistes. Les sociétés asiatiques, en pleine mutation, doivent composer avec ces crispations de genre. À Taïwan, où l’égalité hommes-femmes est érigée en valeur, l’existence en sous-main de poches de misogynie militante est un paradoxe qu’il ne faut pas ignorer. Les médias et les chercheurs commencent à s’emparer du sujet pour l’analyser de façon dépassionnée. Le gouvernement taïwanais, de son côté, a récemment renforcé les actions d’éducation à l’égalité et de prévention du harcèlement sexiste, conscient que la bataille se joue aussi dans les esprits en ligne.
Le phénomène de la manosphère asiatique illustre finalement comment une partie de la jeunesse masculine navigue difficilement entre un héritage patriarcal qui se délite et de nouveaux modèles égalitaires qu’elle n’arrive pas toujours à investir positivement. Le dialogue hommes-femmes apparaît plus que jamais nécessaire pour désamorcer les méfiances réciproques. Certains observateurs notent d’ailleurs qu’une minorité de ces hommes en colère peuvent évoluer : des témoignages d’anciens incels ou « repentis » du machisme montrent qu’un travail sur soi et l’ouverture aux autres finissent par porter leurs fruits. À Taïwan et ailleurs, la progression du masculinisme n’est pas une fatalité, mais elle appelle une vigilance. Mieux comprendre ces mouvements – sans complaisance mais sans diabolisation hâtive – est un premier pas pour y répondre. C’est tout l’enjeu d’une société qui aspire à l’égalité : intégrer tout le monde dans le débat, y compris ces hommes qui se sentent perdus, afin de construire un avenir où l’émancipation des unes ne soit pas perçue comme la menace des autres.

📰 En savoir ➕ 📰
Pour #approfondir et #compléter votre lecture, nous vous recommandons de découvrir les articles suivants :
- ⏯ Le mouvement #MeToo à Taïwan Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
- ⏯ Egalité des sexes à Taïwan Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
- ⏯ Freedom Pineapples à Taïwan Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
🤝 Programme d’affiliation 🤝
📌 Certains liens de cet article, ainsi que certaines images, renvoient vers des liens sponsorisés, permettant à Insidetaiwan.net de toucher une commission en cas d’achat, sans aucun coût supplémentaire pour vous. 💰 Cela nous aide à financer le magazine et à continuer à vous offrir un contenu indépendant et de qualité. 📖✨
💞 Soutenez-nous 💞
- ⏯ Nous soutenir #financièrement
- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters
- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux
- ⏯ Devenir #partenaire
- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu
- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)
Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.