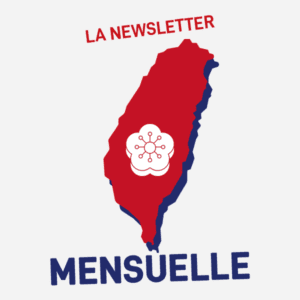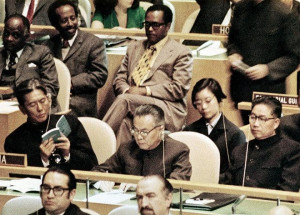La Chine a multiplié les efforts pour séduire les Taïwanais par des moyens pacifiques, qu’il s’agisse de divertissement, d’échanges culturels ou d’incitations économiques. Pourtant, cette stratégie de soft power déployée par Pékin peine à convaincre une population toujours plus méfiante. Au fil des années, l’opinion taïwanaise s’est détournée des contenus venus de Chine et a vu son identité propre se renforcer. Faute de pouvoir gagner les cœurs par le soft power, Pékin voit l’écart se creuser avec Taipei – un fossé qui ravive les tensions et interroge sur la suite de sa politique insulaire.
Déclin de l’influence des médias chinois
Les feuilletons télévisés et la pop music de Chine, autrefois prisés à Taïwan, ont perdu de leur lustre. La censure imposée par Pékin y a stérilisé la créativité et injecté une propagande nationaliste peu subtile, lassant un public taïwanais habitué à la liberté de ton. Résultat, les spectateurs délaissent ces divertissements venus du continent pour se tourner vers leurs propres médias locaux, où les artistes s’expriment sans entraves. Même les vedettes chinoises ne font plus recette sur l’île.
Au contraire, plusieurs polémiques ont creusé le fossé : des célébrités de Chine populaire ont dû s’excuser publiquement pour avoir simplement appelé Taïwan un « pays », ou proclamer leur loyauté à Pékin pour apaiser les autorités. Ces épisodes, très médiatisés, n’ont fait qu’alimenter le ressentiment du public. En 2016, par exemple, la jeune chanteuse taïwanaise Chou Tzuyu (周子瑜) a été contrainte de s’excuser d’avoir brandi le drapeau de Taïwan à la télévision – une humiliation qui a choqué l’île entière. Parallèlement, Pékin a cherché à étendre son emprise sur le paysage informationnel taïwanais en finançant des organes de presse locaux acquis à sa cause. De telles ingérences ont été peu à peu mises au jour, provoquant un tollé en faveur de la liberté d’expression.
Quant aux campagnes de désinformation orchestrées depuis la Chine – rumeurs en ligne ou infox en période électorale –, elles sont régulièrement identifiées et tournées en dérision par les Taïwanais. Une étude de 2023 du Ministère taïwanais des Affaires numériques (數位發展部) révèle d’ailleurs que plus de 70 % des jeunes Taïwanais se méfient des médias pro-Pékin. En somme, plus Pékin tente de manipuler l’information, plus son influence recule au sein de la société taïwanaise.
Coercition économique : une stratégie en échec
La Chine a longtemps pensé que son poids économique lui permettrait de garder Taïwan dans son orbite. Dans les années 2000, de nombreuses entreprises taïwanaises se sont implantées en Chine continentale, attirées par un marché en plein essor. Mais cette dépendance, autrefois perçue comme une opportunité, est aujourd’hui considérée comme un risque. Avec le ralentissement de l’économie chinoise et l’incertitude politique, beaucoup de sociétés de l’île réorientent leurs investissements vers l’Asie du Sud-Est ou les États-Unis. Pékin, de son côté, a durci le ton en conditionnant ses avantages économiques à une ligne politique pro-Chine.
Les marques ou personnalités refusant d’afficher allégeance s’exposent à des représailles. Plutôt que de rallier Taïwan, cette approche a renforcé la méfiance. Même l’accord-cadre de coopération économique de 2008 (ECFA), qui avait un temps rapproché les deux économies, n’a pas enraciné Taïwan dans l’orbite de Pékin sur la durée – la crainte d’une dépendance excessive a fini par l’emporter. Ces dernières années ont été marquées par plusieurs coups de pression de Pékin qui illustrent l’échec de sa stratégie économique :
- Tourisme asphyxié : dès 2016, la Chine a drastiquement restreint les voyages touristiques de ses ressortissants vers Taïwan, privant l’île de millions de visiteurs (un manque à gagner évalué à 18 milliards de dollars taïwanais, soit ~530 millions d’euros par an).
- Boycotts ciblés : des campagnes de boycott ont visé des enseignes taïwanaises en Chine – ainci, en 2019, plusieurs chaînes de bubble tea ont été « blacklistées » sur les réseaux sociaux chinois pour ne pas avoir soutenu la ligne de Pékin sur Hong Kong.
- Embargos commerciaux : en 2021, Pékin a brusquement interdit l’importation des ananas taïwanais invoquant un prétexte sanitaire, une mesure largement interprétée comme politique. Des groupes taïwanais implantés en Chine ont aussi subi des contrôles fiscaux et amendes s’ils étaient jugés trop proches du courant pro-indépendance.
Loin de faire plier Taïwan, ces actions punitives ont accru la défiance de la population envers Pékin. De nombreux entrepreneurs préfèrent désormais diversifier leurs marchés plutôt que de dépendre du continent. D’après le Ministère taïwanais de l’Économie (經濟部), les investissements approuvés de Taïwan vers la Chine continentale sont tombés à environ 3 milliards de dollars US en 2022 (≈2,7 milliards d’euros) – un volume important mais nettement supplanté par les capitaux dirigés vers d’autres pays. La Chine continue d’offrir des incitations financières aux Taïwanais disposés à se conformer à ses exigences, tout en sanctionnant les récalcitrants. En définitive, au lieu de renforcer les liens, la coercition économique de Pékin a rendu toute relation avec la Chine continentale plus coûteuse politiquement, faisant de l’engagement auprès de celle-ci un fardeau plus qu’un atout aux yeux de beaucoup sur l’île.
L’essor de l’identité taïwanaise
Le sentiment identitaire taïwanais n’a jamais été aussi affirmé qu’aujourd’hui. D’après un sondage de 2023 de l’Université nationale Chengchi (國立政治大學), 63 % des habitants de l’île se considèrent exclusivement taïwanais, et la proportion est encore plus élevée chez les jeunes générations. Pékin a largement sous-estimé cette évolution, en présumant que le lien d’appartenance à la « Chine » resterait fort à Taïwan. C’est tout l’inverse qui se produit : les Taïwanais se perçoivent de plus en plus comme un peuple à part, avec sa propre histoire et son propre système politique.
La reprise en main musclée de Hong Kong (香港) en 2019 a joué le rôle de catalyseur. Beaucoup de Taïwanais observaient jusqu’alors avec prudence le modèle « un pays, deux systèmes » proposé par Pékin pour une éventuelle réunification. Mais après la suppression des libertés à Hong Kong, ce modèle a perdu toute crédibilité aux yeux du grand public taïwanais. L’idée même d’une unification avec la Chine suscite désormais une forte inquiétude, perçue comme une menace directe pour la démocratie taïwanaise. La présidente Tsai Ing-wen (蔡英文), réélue triomphalement en 2020 sur cette ligne de fermeté vis-à-vis de Pékin, a incarné cette affirmation identitaire. Elle a martelé que l’avenir de Taïwan devait être décidé par ses 23 millions d’habitants – un message approuvé par plus de 85 % de la population selon les sondages officiels – et a refusé catégoriquement le principe d’« un pays, deux systèmes ». Ce que le nouveau président Lai continue de proclamer.
Au-delà du discours, Taïwan oppose une véritable résistance culturelle et civique à l’influence chinoise. Les autorités soutiennent des programmes d’éducation aux médias pour armer la population contre la propagande extérieure. La société civile s’emploie à valoriser la culture locale – que ce soit via la musique, le cinéma, la littérature ou la préservation de la mémoire historique – afin de renforcer un sentiment national propre. En définitive, plus Pékin cherche à imposer son récit sur l’identité de l’île, plus les Taïwanais réaffirment qu’ils sont maîtres de leur destin et différents de la Chine.
Désinformation : la riposte de Taïwan
Le champ numérique est devenu un terrain d’affrontement majeur entre Pékin et Taipei. La Chine mène une véritable guerre de l’information pour tenter d’orienter l’opinion publique taïwanaise en sa faveur. Ces dernières années, des campagnes de désinformation sophistiquées – rumeurs virales, manipulations sur les réseaux sociaux, cyberattaques – ont visé à peser sur les débats politiques taïwanais, notamment à l’approche des élections. De faux comptes en ligne diffusant des infox sur Facebook, Line ou YouTube, souvent liés à la « cyber-armée » du continent, ont cherché à exacerber les divisions internes ou à discréditer des figures politiques en froid avec Pékin.
Mais face à cette offensive, Taïwan n’est pas restée démunie. Sous l’administration Tsai Ing-wen, l’arsenal de défense informationnelle s’est nettement renforcé. En 2022, le gouvernement a créé un Ministère des Affaires numériques (數位發展部) spécialement chargé de coordonner la lutte contre les ingérences en ligne. Ce ministère pilote la contre-offensive dans le cyberespace : il soutient les initiatives privées de fact-checking (comme le Taiwan Fact-Check Center) qui traquent et démontent les fausses nouvelles, finance des programmes de sensibilisation à l’éducation médiatique dès l’école, et intervient directement sur les réseaux sociaux pour démentir les rumeurs dangereuses.
Parallèlement, Taïwan a durci son cadre légal pour dissuader les financements politiques occultes et l’ingérence étrangère, tout en veillant à préserver la liberté d’expression. La mobilisation est aussi citoyenne : des ONG et collectifs locaux innovent pour réduire l’impact de la propagande venue de Chine. Ainsi, des ateliers pédagogiques ciblent les personnes âgées – souvent plus vulnérables face aux infox – afin de les aider à reconnaître les contenus manipulatoires en ligne.
Cette vigilance tous azimuts porte ses fruits : plusieurs tentatives d’influence chinoises ont été publiquement exposées et tournées en ridicule, rendant leurs auteurs identifiables et leurs messages moins crédibles. Des experts internationaux estiment d’ailleurs que Taïwan sert de laboratoire aux tactiques d’ingérence de Pékin, ce qui a conduit l’île à développer une résilience unique. Gouvernement, médias et société civile collaborent étroitement pour protéger l’espace informationnel démocratique. Ainsi, la population taïwanaise, globalement très connectée, aborde désormais les nouvelles en provenance de Chine avec un esprit critique affûté – rendant la tâche de Pékin d’autant plus ardue pour gagner la bataille de l’opinion.
Perspectives pour Pékin
Malgré ces revers, l’influence chinoise à Taïwan n’est pas totalement nulle. Pékin conserve quelques leviers de soft power, à commencer par les liens culturels et humains persistants entre les deux sociétés. Des échanges touristiques, éducatifs ou religieux subsistent : chaque année, des milliers de Taïwanais se rendent en Chine pour des pèlerinages bouddhiques ou des festivals traditionnels communs, et vice-versa. Toutefois, ce rapprochement culturel n’a débouché sur aucun gain politique tangible pour Pékin – ces voyageurs et étudiants ne reviennent pas conquis par l’idée d’unification pour autant.
Consciente de l’échec relatif de sa stratégie actuelle, la Chine envisage de la recalibrer. D’après plusieurs analystes, Beijing pourrait accentuer ses efforts d’influence numérique, en investissant massivement les plateformes sociales en ligne prisées des jeunes Taïwanais ou en utilisant l’intelligence artificielle pour cibler plus finement ses messages de propagande. Une diplomatie plus subtile, misant sur les échanges universitaires, sportifs ou artistiques sans arrière-pensée ouvertement politique, fait également partie des scénarios discutés. Par ailleurs, certains observateurs estiment que l’évolution de la position taïwanaise dépendra aussi des circonstances internes : si Taïwan traverse une grave crise économique ou si un gouvernement plus conciliant envers Pékin arrivait au pouvoir à Taipei, un rapprochement pragmatique pourrait avoir lieu sur le front économique.
Pékin mise d’ailleurs sur cette carte en attendant des jours plus favorables. Cependant, tant que la Chine continuera d’assortir son « offre » de rapprochement de menaces militaires ou de conditions politiques inacceptables pour les Taïwanais, il est peu probable qu’elle renverse la tendance défavorable. Pour réellement regagner du terrain dans l’opinion de l’île, la Chine devrait opérer un profond changement d’approche. En clair, privilégier enfin un soft power authentique plutôt que le double langage.
Cela impliquerait de promouvoir de véritables échanges culturels et universitaires, d’autoriser une plus grande liberté créative à ses artistes (afin que films et chansons venus de Chine inspirent à nouveau le public taïwanais), et d’offrir des partenariats économiques avantageux sans coercition ni ultimatums politiques. Des voisins asiatiques offrent un modèle de soft power réussi : le Japon ou la Corée du Sud, par exemple, diffusent efficacement leur culture à l’étranger sans poser de conditions, gagnant une influence positive durable. En l’état actuel, l’échec de la stratégie chinoise à Taïwan souligne une réalité simple mais fondamentale : on n’achète pas le cœur d’une population à coups de pressions. Tant que Pékin ne repensera pas en profondeur sa manière de faire, son rêve de rallier pacifiquement Taïwan restera hors de portée.
Devant cet échec manifeste de son soft power, Pékin semble ne plus avoir d’autre choix que de durcir son discours, en multipliant les démonstrations de force et les déclarations hostiles. Ce glissement vers un langage plus radical et agressif, observé ces derniers mois, s’explique en partie par l’impuissance ressentie à séduire Taïwan par des moyens pacifiques.
📌 Ce qu’il faut retenir
📺 Influence culturelle en berne : Les contenus médiatiques chinois (séries, musique) perdent du terrain à Taïwan du fait de la censure et de la politisation, le public privilégiant les productions locales libres.
💰 Pressions économiques contre-productives : Les tentatives de Pékin de peser sur Taïwan via le tourisme, le commerce ou les entreprises ont surtout renforcé la méfiance des Taïwanais au lieu de gagner leur loyauté.
🆕 Identité taïwanaise renforcée : Une nette majorité de Taïwanais se définissent uniquement comme tels, nourrissant une fierté nationale et un attachement à la démocratie qui les rendent peu enclins à l’unification avec la Chine.
🤔 Pékin appelée à se réinventer : La Chine doit repenser sa stratégie de soft power – en misant sur des échanges sincères et non sur la coercition – si elle veut un jour réduire le fossé avec Taïwan et éviter une escalade des tensions.

📰 En savoir ➕ 📰
Pour #approfondir et #compléter votre lecture, nous vous recommandons de découvrir les articles suivants :
- ⏯ Manipulation chinoise autour de la résolution de 2758 Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
- ⏯ Chinese Taipei aux Jeux Olympiques Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
- ⏯ Débarquement allié une source d’inspiration pour la Chine Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
🤝 Programme d’affiliation 🤝
📌 Certains liens de cet article, ainsi que certaines images, renvoient vers des liens sponsorisés, permettant à Insidetaiwan.net de toucher une commission en cas d’achat, sans aucun coût supplémentaire pour vous. 💰 Cela nous aide à financer le magazine et à continuer à vous offrir un contenu indépendant et de qualité. 📖✨
💞 Soutenez-nous 💞
- ⏯ Nous soutenir #financièrement
- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters
- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux
- ⏯ Devenir #partenaire
- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu
- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)
Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.