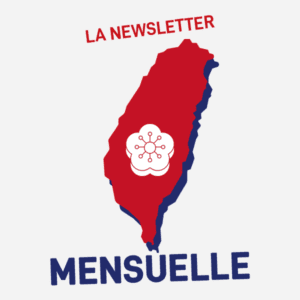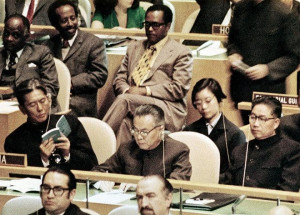City of Lost Things (titre original : 廢棄之城, 2021) est un film d’animation taïwanais en images de synthèse réalisé par Yee Chih-Yen, connu auparavant pour le film culte Blue Gate Crossing. Cette première incursion du cinéaste dans l’animation (fruit de dix ans de travail) a été largement saluée en festivals : sélectionné au prestigieux Festival d’Annecy 2021 (compétition Contrechamp) et au Stuttgart ITFS, il a remporté le Golden Horse du meilleur film d’animation 2020 à Taipei. Porté par un casting vocal de premier plan (Joseph Chang, River Huang, Gwei Lun-mei, Jack Kao et Lee Lieh), ce long-métrage allie fable fantastique et critique sociale. Il suit l’aventure d’un adolescent fugueur et d’un sac plastique parlant dans une cité peuplée de déchets vivants, abordant des thèmes profonds tels que l’adolescence en crise, l’abandon et la quête d’identité.
Une fantaisie visuelle au milieu des ordures
Dès les premières images, City of Lost Things déploie une identité visuelle forte en transformant un dépotoir urbain en royaume fantasmagorique. Le film utilise une animation 3D en CGI volontairement simple, loin du photo-réalisme high-tech des studios Pixar, mais fait preuve d’une inventivité remarquable dans l’utilisation de ses éléments numériques de base. Cette approche « budget modeste » ne rime pas avec pauvreté artistique, bien au contraire. Le design de la Trash City (la « Cité des Choses Perdues ») fourmille de détails créatifs : la direction artistique conçoit un univers steampunk de bric et de broc peuplé de mannequins-horaires aux têtes remplacées par des lampes, de réfrigérateurs et haut-parleurs dansants façon disco, ou encore de nuées de sacs plastiques volants évoquant une méduse aérienne. Chaque recoin du décor recycle des éléments du monde réel, vieux téléviseurs, chariots de supermarché, jouets cassés, pour les intégrer dans la topographie onirique de la ville. Visuellement, le résultat est à la fois enchanteur et légèrement glauque, teinté d’une ambiance presque Tim Burton-ienne par moments.
L’animation elle-même, sans être ultra-fluide, parvient à donner vie à des objets inanimés avec ingéniosité. Par exemple, Baggy (le sac plastique) n’est qu’un sac ordinaire sans visage ni membres, et pourtant il vibre d’émotions grâce à ses mouvements subtils et une excellente animation des matières plastiques. Certaines séquences marquent les esprits par leur créativité visuelle : l’accueil de Leaf par un essaim de sacs plastiques voletant dans le ciel de la décharge, une scène de fête endiablée où instruments de musique et électroménagers abandonnés dansent sous une boule à facettes, ou encore la course-poursuite effrénée d’une bombe de peinture giclant ses couleurs à travers les ruelles encombrées. Les jeux de couleurs oscillent entre les tons ternes et rouillés de la ferraille et des éclats néon surprenants lors des moments oniriques (lumières vives du disco, halos fluorescents des déchets toxiques). Cette palette contrastée souligne le caractère à la fois bleak (sombre) et magique de ce monde parallèle.
L’ambiance sonore n’est pas en reste : la bande-son mêle des bruitages ingénieux, grincements de métal, souffle du vent dans les sacs plastiques, vacarme assourdissant des camions-bennes, à une musique tantôt mélancolique, tantôt électrisante lors des scènes d’action. Une scène emblématique montre Baggy se laissant porter par le vent dans une danse du sac plastique aussi poétique qu’étrangement belle, clin d’œil à la célèbre scène d’American Beauty où un sac vole dans un tourbillon d’air. Enfin, la direction artistique a été récompensée localement : le film a remporté, en plus du Golden Horse, plusieurs prix au Festival du film de Taipei (meilleure direction artistique, meilleurs effets spéciaux et costumes) qui soulignent l’excellence de son univers visuel. City of Lost Things prouve qu’une animation au style modeste peut « en faire beaucoup avec peu » grâce à un imaginaire débordant, et offre au spectateur un voyage visuel, où la beauté surgit littéralement des ordures.

Adolescence, identité et déchets dans une fable sociale
Le scénario suit un schéma narratif d’aventure initiatique tout en abordant frontalement le mal-être adolescent. Leaf (surnom signifiant « Feuille » ou Petit Arbre, appelé Xiao-Shu en VO) est un garçon de 16 ans en rupture : il fugue de chez lui, fuyant une mère alcoolique et un quotidien où il se sent rejeté. Dans un prologue percutant, sa voix off exprime son dégoût de la maison, de l’école, de la rue, en somme, de la vie. Persuadé de n’avoir « nul part où aller », il erre jusqu’à se faire happer par un camion poubelle géant qui l’entraîne malgré lui dans un monde parallèle. Il atterrit ainsi à Trash City, une cité étrange peuplée de déchets vivants (objets cassés, jouets abandonnés, emballages usagés) qui parlent et s’organisent en société. Cette idée narrative, un royaume secret d’objets jetés, évoque immanquablement Toy Story (dont un personnage, le dinosaure Rex, fait d’ailleurs un caméo humoristique dans le film) ou encore le court-métrage Plastic Bag (2009) où un sac plastique conscient raconte sa vie éternelle d’objet perdu. Cependant, ici le ton est plus sombre : Trash City fonctionne comme une métaphore explicite du mal de vivre de Leaf, qui se considère lui-même comme un « déchet humain » à la dérive.
Accompagné par Baggy (Ah-Dai en chinois, littéralement « Sac »), un sac plastique usé d’une trentaine d’années qu’il a sauvé de la benne, Leaf découvre une communauté d’objets qui, malgré leur statut d’ordures, ont formé une société avec ses règles et ses espoirs. Baggy, optimiste et déterminé, refuse de se voir comme un simple rebut sans valeur. Il rêve de s’évader de Trash City pour trouver une utopie légendaire où lui et ses compagnons pourraient « devenir quelque chose d’autre que des déchets ». Ce mythe de la terre promise prend ici la forme d’un lieu mystérieux au-delà des murs de la décharge, qui se révélera ironiquement être un centre de recyclage dans le dénouement du film. En attendant, Baggy monte une petite résistance de détritus rebelles prêts à tout pour franchir les frontières de la cité. Mais leur route est barrée par deux forces oppressives : d’une part, les camions-bennes blindés (les “Armors”), véritables monstres mécaniques patrouillant pour aspirer les dissidents et les broyer dans leurs compacteurs arrières ; d’autre part, le souverain de Trash City, Mr. G, un imposant dieu local de la décharge. Mr. G est représenté comme une statue traditionnelle de divinité chinoise (évoquant le général légendaire Guan Yu) qui parle et impose sa loi : il interdit aux déchets de s’enfuir soi-disant pour leur propre sécurité, afin qu’ils évitent de finir pulvérisés par les camions à l’extérieur. Ce despote paternaliste, vénéré et craint à la fois, symbolise une autorité qui protège autant qu’elle asservit, un double discours qui donne une dimension politique à la fable.
Le cœur dramatique du récit réside dans le conflit intérieur de Leaf. Ironiquement, alors que Baggy et les autres déchets rêvent de quitter cet exil, Leaf, lui, ne veut plus repartir. Pour ce garçon meurtri, Trash City représente un refuge où, paradoxalement, il se sent enfin accepté tel qu’il est, puisqu’ici tout le monde est “bon à jeter” comme lui. Il s’attache désespérément à sa nouvelle amitié avec Baggy, au point que lorsque ce dernier prépare son évasion avec d’autres, Leaf trahit ses compagnons en dénonçant leur plan à Mr. G, par peur d’être de nouveau abandonné et seul. Ce passage, où le protagoniste commet l’irréparable par insécurité affective, est assez audacieux pour un film d’animation destiné en partie aux jeunes : il présente un héros imparfait, égoïste et en colère, dont les erreurs auront des conséquences graves. Leaf devra ensuite affronter sa culpabilité et choisir entre persister dans son apathie auto-destructrice ou aider Baggy malgré tout. Cette évolution narrative illustre avec justesse le thème de la quête d’identité : Leaf doit surmonter son sentiment d’invisibilité et d’indignité pour croire qu’il a, lui aussi, une place dans le monde réel, « un endroit où il peut mener une vie heureuse entouré de gens qui l’aiment » sans se considérer lui-même comme un déchet. La parabole est limpide : apprendre à s’aimer soi-même est le premier pas pour s’extraire d’une situation désespérée.
Sur le plan thématique, City of Lost Things aborde frontalement l’adolescence à la marge et le sentiment d’abandon. Leaf incarne ces jeunes que la société oublie ou maltraite, enfant de foyer dysfonctionnel, victime de violences scolaires, il se vit comme un paria. La cité poubelle qu’il rejoint est une matérialisation de sa dépression et de son isolement. Le film traite ainsi de la santé mentale des adolescents de manière métaphorique, un peu à la façon d’un Inside Out (Pixar) qui externaliserait le chaos intérieur, sauf qu’ici, le paysage psychique est un dépotoir peuplé de déchets parlants. L’autre grande thématique est l’obsolescence et le rejet, tant au niveau des objets de consommation que des êtres humains. En filigrane, le scénario critique une société du gaspillage qui jette aussi bien les choses que les personnes. Les déchets animés représentent clairement les populations marginalisées (sans-abris, exclus, oubliés) qui « méritent mieux et aspirent à échapper » à leur condition. Comme le souligne un critique, la ville de Lost Things fonctionne comme « un cri pour reconnaître la valeur des invisibles », ces âmes perdues que la société traite comme des moins que rien. Cette dimension de sous-texte social est prégnante tout au long du film et donne du relief à l’intrigue fantastique.
Le scénario n’est pas exempt de faiblesses pour autant. Quelques facilités ou incohérences ont été relevées, par exemple un stratagème où les objets en fuite incendient une partie de la ville pour distraire leurs poursuivants, alors que cette menace était déjà écartée à ce moment du récit. De même, le climax s’étire avec un épilogue un brin appuyé, où le message écologique et humaniste du film est explicité de façon un peu lourde, au risque de verser dans le didactisme. Par ailleurs, si le ton global s’adresse aux adolescents, certaines scènes surprennent par leur décalage : notamment un gag où Leaf tombe sur un préservatif usagé et s’interroge à haute voix s’il est vivant, moment incongru oscillant entre humour adulte et malaise, qui éclipse presque le reste du film tant il détonne dans une œuvre censée toucher un jeune public. Néanmoins, malgré ces bémols, l’histoire reste efficacement menée et émouvante. La fable des exclus en quête d’utopie n’a certes rien de complètement inédit, mais elle est traitée ici avec assez de sincérité et d’énergie pour emporter l’adhésion. Le film alterne habilement passages d’action (courses-poursuites, affrontements avec les camions broyeurs) et moments plus posés de réflexion ou de tendresse entre Leaf et Baggy. En fin de compte, City of Lost Things propose une aventure initiatique touchante, doublée d’une réflexion sociale sur la valeur de chacun, même des « moins que rien ». C’est une histoire qui encourage à ne pas se résigner à être un déchet, à trouver en soi la force du changement, quitte à passer par la case recyclage, littéralement et métaphoriquement.
Des voix stars au service des émotions
Pour donner vie à son univers d’objets animés, City of Lost Things s’est offert un casting vocal prestigieux, composé de vedettes du cinéma taïwanais. Cette distribution atypique, des acteurs célèbres plutôt que des doubleurs professionnels, s’avère globalement judicieuse tant chacun apporte sa personnalité aux personnages animés. Joseph Chang (Chang Hsiao-chuan) prête sa voix à Baggy, le sac plastique philosophe. Connu pour ses rôles intenses à l’écran, il insuffle ici à son personnage en apparence banal une étonnante profondeur. Sa voix posée, capable d’intonations tantôt espiègles tantôt graves, rend Baggy immédiatement sympathique et crédible en mentor plein d’entrain. À travers ses inflexions chaleureuses, on perçoit la détermination et l’idéal qui animent ce vieux sac usé, transformant ce déchet insignifiant en véritable héros charismatique. Face à lui, River Huang (Huang He) incarne Leaf/Xiao-Shu, l’adolescent tourmenté. Son jeu vocal retranscrit avec justesse l’apathie blasée, la colère contenue puis l’émotion vulnérable du jeune garçon au fil de son parcours. La voix de River Huang, naturellement un peu rauque et nonchalante, correspond bien à un ado renfermé ; elle permet de ressentir le mal-être du personnage, sans tomber dans la caricature du « jeune qui boude ». Lors des scènes d’intense frustration ou de panique, l’acteur monte en puissance et parvient à transmettre une douleur sincère, rendant Leaf touchant malgré ses défauts.
Les seconds rôles vocaux ne sont pas en reste et ajoutent des couleurs variées à la palette du film. Jack Kao, vétéran du cinéma, campe avec brio la voix de Mr. G, le dieu de la cité-décharge. Son timbre grave et imposant confère à cette statue de divinité une autorité naturelle et une aura intimidante. Par ses intonations paternalistes mâtinées de menace voilée, Jack Kao réussit à faire de Mr. G un antagoniste mémorable, à la fois protecteur et terrifiant, presque un gourou de secte qui maintient ses ouailles captives sous couvert de bienveillance. Lee Lieh, également productrice du film, interprète un personnage nommé « Ah-Tie » : sa voix féminine mure apporte une touche d’expérience et de sagesse bourrue, peut-être dans le rôle d’une vieille ferraille ou d’une « dame décharge » (le détail du personnage importe peu, mais sa présence vocale ajoute de la gravité). Gwei Lun-mei, figure emblématique du cinéma taïwanais depuis Blue Gate Crossing, fait ici une apparition vocale plus surprenante : elle incarne… un GPS parlant ! Avec malice, elle donne à ce gadget électronique une voix féminine douce mais un peu monotone, répétant un tic de langage amusant (son personnage ponctue ses indications de « Aiyoo, aiyoo », expression de dépit en chinois), un détail insolite qui apporte un léger humour absurde. Même si son rôle est bref, la prestation de Gwei Lun-mei marque les esprits par son décalage comique, montrant que même un objet moderne anodin peut avoir sa petite personnalité excentrique.

L’alchimie du casting vocal fonctionne donc très bien. Chaque acteur apporte une crédibilité émotionnelle aux protagonistes animés : on ressent la camaraderie sincère entre Leaf et Baggy grâce à l’authenticité de leurs échanges, on frissonne devant la colère tonitruante de Mr. G grâce à la voix caverneuse de Jack Kao. Le choix de stars de cinéma contribue aussi à élargir le public potentiel du film au-delà des seuls enfants, en rassurant les spectateurs adultes avec des noms familiers. On pourrait craindre que des acteurs non spécialisés en doublage manquent de technique, mais ici ils s’en sortent haut la main, portés par un scénario qui leur permet d’exprimer toute une gamme d’émotions. La justesse des émotions transmises est notable : Joseph Chang rend tangible la bienveillance un peu mélancolique de Baggy, River Huang laisse percer la détresse sous l’angoisse adolescente de Leaf, et même les touches d’humour passent bien grâce à la conviction des interprètes (par exemple, l’étonnement dégoûté dans la voix de River Huang quand Leaf tombe sur le préservatif “vivant” fait sourire malgré la bizarrerie de la scène). En somme, le doublage de City of Lost Things est un atout majeur du film. Le pari de la production de confier les rôles à des acteurs célèbres s’avère payant : non seulement le casting est pertinent vis-à-vis des personnages (un ado incarné par un jeune acteur, un sac sage par une voix masculine mature, etc.), mais ces voix familières ajoutent une dimension de star power qui aide à promouvoir le film sur un marché local peu habitué aux longs-métrages d’animation nationaux. Qu’il s’agisse de transmettre la tristesse, la colère ou l’espoir, les comédiens vocaux de City of Lost Things livrent une performance sincère qui donne une âme à cette cité des déchets.
Miroir d’une société en mutation
Bien que son propos soit universel, City of Lost Things s’enracine profondément dans la réalité et la culture taïwanaise contemporaine. La cité des déchets qu’il dépeint peut se lire comme une allégorie des revers de l’urbanisation accélérée qu’a connue Taïwan ces dernières décennies. L’archipel, autrefois affublé du surnom peu flatteur d’« Île poubelle » dans les années 1980 en raison de problèmes de gestion des déchets, a depuis fait de gros progrès en recyclage, un thème central du film. Yee Chih-Yen propose ici une forme de conte écologique : en donnant littéralement vie aux détritus, il souligne l’importance de ne pas enfouir sous le tapis nos ordures et, par extension, nos problèmes de société. Le film traduit les préoccupations environnementales de son auteur de manière poétique : Baggy et ses amis refusent de « rester des déchets à jamais » et cherchent à « devenir utiles à nouveau » en se recyclant. Cette quête utopique vers le recyclage représente l’espoir d’une transformation positive, un écho au discours écologique prônant la seconde vie des objets et la durabilité. Dans un pays comme Taïwan qui a lancé des politiques ambitieuses de tri sélectif et de réduction des déchets, City of Lost Things s’inscrit pleinement dans l’air du temps en matière de sensibilisation environnementale. Le message final (sans divulgâcher) aborde explicitement la notion de cycle de vie et de renaissance à travers le recyclage, bouclant la boucle de cette parabole environnementale.
Par ailleurs, le film offre un regard critique sur la société taïwanaise et ses laissés-pour-compte. Leaf, le jeune héros, est emblématique d’une jeunesse marginalisée qui peine à trouver sa place dans une société compétitive. Son histoire personnelle (fugue, décrochage scolaire, violences subies) reflète les défis auxquels font face certains adolescents à Taïwan, entre la pression du système éducatif, la désintégration familiale et l’absence de soutien social pour les plus fragiles. En ce sens, City of Lost Things rejoint des préoccupations locales très actuelles : la santé mentale des jeunes, le sort des enfants de familles monoparentales ou dysfonctionnelles, et plus largement la question du bien-être de la jeunesse dans une société en mutation. Taïwan, malgré sa modernité, connaît comme ailleurs des cas d’ados en rupture, de « jeunes invisibles » qui décrochent. Le film leur offre une métaphore puissante : celle d’une ville cachée où s’amassent tous ceux dont le monde ne veut plus. Il y a là une critique implicite d’une société qui a tendance à “écraser les individus” trop faibles ou non conformes, comme l’indique le synopsis officielr. Yee Chih-Yen, qui a souvent traité des inégalités sociales et de la jeunesse dans ses œuvres précédentes, utilise l’animation comme un moyen de dénoncer en douceur ces travers. City of Lost Things hérite ainsi d’une tradition du cinéma d’animation taïwanais engagé : à l’instar du film Happiness Road (2018) qui abordait la mémoire collective et l’enfance sur fond d’évolution socio-politique de Taïwan, il propose une réflexion sur « les maux de son époque à travers la fiction ». En particulier, le film met en parallèle déchets urbains et détresse humaine, soulignant combien la course au progrès matériel (urbanisation, consommation) peut générer du rebut (matériel et humain) si l’on n’y prend garde.
Le choix de représenter le dieu de la ville sous les traits d’une statue de Guan Yu est également révélateur du contexte culturel. Guan Yu, figure de fidélité et de droiture dans la tradition chinoise, est souvent vénéré à Taïwan (dans les temples ou les commerces) comme protecteur. Le détourner en tyran bienveillant de la décharge constitue une satire subtile : cela peut symboliser la manière dont les traditions ou autorités locales, sous prétexte de protection, peuvent en réalité figer une situation injuste. Mr. G emprisonne les déchets “pour leur bien”, à l’image de certaines structures sociales qui cloisonnent les individus dans des rôles subalternes sous couvert d’ordre établi. Cette dimension peut évoquer des réalités taïwanaises, par exemple la manière dont les populations défavorisées sont parfois contenues dans des quartiers précaires ou comment les sans-abris de Taipei sont tenus à l’écart des quartiers touristiques. Le film, sans désigner clairement un coupable, incite à réfléchir sur la responsabilité collective envers « ceux qui vivent dans nos rues ».
Enfin, il faut souligner que City of Lost Things a bénéficié d’un soutien institutionnel notable à Taïwan. Produit par Lee Lieh et sa société One Production Film, en partenariat avec le géant local du jeu vidéo Gamania Digital Entertainment, et soutenu financièrement par la Taichung Film Development Foundation, le film représente une ambitieuse collaboration entre cinéma, animation et industrie tech taïwanaise. Son succès critique (Golden Horse, Taipei Film Festival) et son rayonnement international (sélection à Annecy, New York Asian Film Festival 2021) ont fait de lui un porte-drapeau de l’animation taïwanaise sur la scène mondiale. Taïwan cherche depuis quelques années à se positionner dans le domaine de l’animation, et Yee Chih-Yen, grâce à sa notoriété, a ouvert la voie en montrant qu’une histoire locale pouvait toucher un public global. En ancrant sa fable dans des thématiques universelles (l’écologie, l’estime de soi, la solidarité) tout en y insufflant l’âme de Taïwan, City of Lost Things offre un regard culturellement spécifique mais compréhensible par tous. C’est en cela un film pionnier qui, à l’image de ses personnages recyclés, transforme le local (déchets de Taipei, mythologie chinoise) en message global d’humanité.

Comparaison avec d’autres œuvres d’animation mondiales
City of Lost Things s’inscrit dans un paysage animé international riche, tout en se distinguant par son ton et son contexte. Il est intéressant de le comparer à certains grands noms de l’animation, de Miyazaki à Pixar, en passant par Michel Ocelot ou le studio Laika, pour mieux cerner son originalité.
Avec l’univers de Hayao Miyazaki (Studio Ghibli), on trouve des parallèles thématiques forts. À l’instar de Spirited Away (Le Voyage de Chihiro), où une jeune fille pénètre un monde secret peuplé de esprits et de créatures symbolisant l’avidité ou la pollution, City of Lost Things fait plonger son héros dans un royaume fantastique allégorique. Les deux films utilisent la fantaisie pour parler de réalités bien concrètes : chez Miyazaki, la perte de repères de Chihiro renvoie à la crise du passage à l’âge adulte et au consumérisme galopant ; chez Yee Chih-Yen, la fuite de Leaf dans la cité des déchets reflète la détresse adolescente et la société du gaspillage. Visuellement en revanche, l’approche diffère : Miyazaki privilégie la 2D dessinée à la main, avec une profusion de détails oniriques et une animation fluide très organique, là où City of Lost Things opte pour une 3D un peu anguleuse et un style plus direct. Le ton aussi diverge quelque peu, le film taïwanais est peut-être plus frontal dans son message (moins de mystère que chez Miyazaki) et ose un protagoniste initialement antipathique, là où les héros ghibliens demeurent attachants malgré leurs failles. Néanmoins, on retrouve chez les deux une poésie de l’étrange : la gare ferroviaire inondée et les dieux-boues puants de Chihiro pourraient côtoyer sans peine les mannequins à tête de lampe et les sacs volants de Lost Things. Sur le plan du public cible, Miyazaki réussit en général à toucher petits et grands grâce à un équilibre subtil entre émerveillement et profondeur. City of Lost Things, avec son atmosphère plus âpre et ses quelques scènes matures, vise plutôt les ados et jeunes adultes, même s’il reste accessible à des enfants accompagnés. En somme, si City of Lost Things n’a pas la finesse poétique ni la virtuosité visuelle d’un Miyazaki, il en partage l’âme humaniste et l’engagement écologique, ce qui le rapproche plus d’un Nausicaä ou d’un Ponyo sur le fond.
Du côté de Pixar, la comparaison s’impose notamment à cause des clins d’œil disséminés dans le film taïwanais. L’hommage à Toy Story est explicite (la présence du dinosaure Rex en figurine caméo), et la thématique des jouets/objets abandonnés qui cherchent un nouveau foyer fait écho à Toy Story 3 ou 4. On peut aussi penser à WALL-E (2008) de Pixar, qui lui aussi animait un monde post-apocalyptique de déchets et faisait passer un message écologique fort. City of Lost Things se situe un peu comme un miroir inversé de WALL-E : dans ce dernier, c’est un robot-épave qui redonne espoir à l’humanité exilée, tandis que dans Lost Things ce sont des humains perdus (Leaf) qui trouvent espoir auprès d’un déchet vivant. Pixar se distingue par une qualité d’animation de pointe et un scénario au cordeau, là où City of Lost Things affiche un style plus artisanal. Cependant, Brian Hioe (critique sur Cinema Escapist) souligne que malgré l’absence de « haute sorcellerie technique », le film taïwanais séduit grâce à son histoire bien ficelée et son animation inventive, prouvant qu’il n’est pas nécessaire d’égaler Pixar en budget pour raconter une bonne histoire. En termes de ton, Pixar mêle habilement humour et émotion, et City of Lost Things tente une approche similaire mais avec un humour plus discret et un angle plus sombre. Par exemple, on retrouve chez les deux la figure du héros outsider (Leaf comme Woody ou Wall-E) et une belle amitié atypique (Leaf/Baggy rappelant un duo à la Buzz et Woody dans l’esprit). Toutefois, City of Lost Things assume une part de désenchantement plus grande, son héros trahit ses amis, un acte qu’on imagine mal chez Pixar où l’amitié triomphe toujours avant la fin du deuxième acte. On pourrait dire que City of Lost Things est à Pixar ce que l’adolescence tourmentée est à l’enfance candide : un pas de plus vers la réalité brutale, tout en gardant une étincelle d’espoir.
Face à l’univers de Michel Ocelot (réalisateur de Kirikou, Azur et Asmar…), City of Lost Things offre un contraste intéressant entre modernité urbaine et contes traditionnels. Ocelot puise souvent dans les récits folkloriques et utilise des techniques d’animation 2D ou en ombres chinoises très stylisées pour livrer des messages de tolérance et d’humanisme. Par exemple, Kirikou et la sorcière se déroulait en Afrique sur fond d’apprentissage de la vie et Azur et Asmar mêlait contes orientaux et fraternité interculturelle. City of Lost Things, de son côté, transpose la morale humaniste dans un contexte hyper-moderne (une métropole et ses ordures) et via une technique 3D numérique. Sur le plan esthétique, on est loin de l’élégance épurée d’Ocelot : le film taïwanais adopte un style plus brut, collage visuel de matériaux hétéroclites, là où Ocelot peint des tableaux raffinés. Néanmoins, les deux partagent le goût du symbolisme et des métaphores fortes. Là où Ocelot utilise la sorcière Karaba pour dénoncer la peur de l’inconnu ou les préjugés, Yee Chih-Yen utilise le dieu de la décharge pour dénoncer l’injustice sociale. Tous deux s’adressent en partie aux enfants, mais avec plusieurs niveaux de lecture. City of Lost Things est sans doute moins adapté aux tout-petits du fait de son héro tourmenté et de son univers parfois effrayant, mais, comme dans les films d’Ocelot, il y a une volonté pédagogique derrière l’aventure. D’ailleurs, on peut rapprocher la fin de City of Lost Things, qui insiste un peu lourdement sur la morale, de la dimension volontiers éducative des œuvres d’Ocelot. Enfin, Ocelot et Yee Chih-Yen ont en commun de mettre en lumière leur culture : l’un fait connaître des légendes d’Afrique de l’Ouest ou de la Méditerranée au monde entier, l’autre introduit des éléments de culture taïwanaise (divinités locales, enjeux de société) dans un format universel qu’est le film d’animation. En cela, City of Lost Things contribue, comme Happiness Road l’avait fait quelques années plus tôt, à replacer Taïwan sur la carte du cinéma d’animation aux yeux du public international.
Quant aux studios Laika (spécialisés dans l’animation en stop-motion avec des films comme Coraline, ParaNorman, Kubo…), on retrouve avec City of Lost Things une parenté dans le goût pour les histoires plus sombres et les protagonistes jeunes confrontés à un univers inquiétant. Par exemple, Coraline mettait en scène une fillette ignorée par ses parents qui découvre un monde parallèle séduisant puis terrifiant – un schéma qui rappelle Leaf trouvant d’abord du réconfort à Trash City avant d’en découvrir l’envers dangereux. Laika et Yee Chih-Yen partagent aussi le courage de ne pas édulcorer la noirceur : City of Lost Things n’hésite pas à montrer une ambiance de fin du monde dans la décharge, avec des engins dévorants effrayants et un sentiment de danger réel, un peu comme ParaNorman traitait de zombies et de malédiction avec un ton sérieux. Visuellement toutefois, Laika travaille en stop-motion, ce qui donne à ses films un cachet artisanal et tangible (personnages en pâte à modeler, décors faits main), assez éloigné de la CGI lisse de City of Lost Things. Mais ironiquement, l’univers de Trash City, avec ses poupées cassées et ses mannequins animés, n’est pas sans rappeler l’esthétique de Coraline ou L’Étrange Noël de M. Jack (produit par Burton) pour son côté grotesque et merveilleux mêlés. On imagine d’ailleurs très bien Laika adapter une histoire pareille en volume, tant le concept de personnages-objets s’y prêterait. Côté message, Laika aborde souvent la thématique de l’acceptation de soi et des autres (les marginaux sont souvent les héros chez eux, cf. The Boxtrolls où des créatures des égouts sont en fait bienveillantes). City of Lost Things est sur la même longueur d’onde, avec son plaidoyer pour la dignité des exclus et sa célébration de la différence. En termes de public, les films Laika ciblent un créneau famille mais plutôt adolescents (beaucoup d’adultes apprécient aussi), ce qui correspond assez bien à City of Lost Things qui, on l’a dit, convient surtout dès 10-12 ans et au-delà.
Face à d’autres studios internationaux, City of Lost Things apparaît comme un OVNI rafraîchissant. Il ne cherche pas à copier le moule Disney (pas de princesse ni de chansons, évidemment) et s’aventure sur des terrains que le grand public voit rarement en animation. On pourrait le rapprocher de certaines œuvres d’animation européennes indépendantes pour son audace thématique, ou de films d’animation chinois qui traitent de société (par exemple Have a Nice Day de Liu Jian, même si celui-ci est beaucoup plus adulte et cynique). En tout cas, City of Lost Things montre que l’animation taïwanaise peut se hisser à un niveau compétitif mondial en proposant sa propre voix. Son ton oscillant entre l’espoir enfantin et la noirceur adolescente le place à mi-chemin entre le divertissement familial et le film d’auteur. Si l’esthétique numérique modeste peut dérouter face aux standards ultra-léchés de Disney/Pixar, elle donne aussi un charme particulier, presque rétro, rappelant certaines animations 3D des années 2000 ou les productions télévisées européennes. Mais c’est surtout par son message que le film se démarque : rare sont les animations qui abordent de front la notion de déchet, matériel et humain, avec une telle empathie. En cela, on peut dire qu’il partage un esprit commun avec des œuvres engagées comme WALL-E (écologie) ou Persepolis (critique sociale animée dans un style personnel), bien qu’il le fasse à sa manière fantaisiste.

Mon Avis ⭐⭐⭐⭐
City of Lost Things est une fable touchante et visuellement inventive qui compense ses limites techniques par un message universel, une poésie rafraîchissante et un fouillis permanent qui en met plein les yeux.
✅ J’ai aimé
- Un mélange réussi de genres : entre conte moral, fable écologique et drame adolescent, le film touche plusieurs publics sans se perdre.
- Un univers visuel singulier : malgré des moyens modestes, l’imaginaire de Trash City frappe par sa créativité et son originalité.
- Un message fort : City of Lost Things montre que l’animation peut aborder des sujets graves comme l’abandon ou la marginalisation.
- Un film profondément taïwanais et universel à la fois : il reflète les réalités locales tout en parlant au monde entier.
- Un beau parcours en festivals : sa sélection à Annecy ou à New York confirme l’écho international du film.
❌ J’ai moins aimé
- Une technique d’animation parfois limitée : la 3D reste en deçà des standards des grands studios comme Pixar ou Ghibli.
- Un récit un peu explicite par moments : certaines scènes soulignent trop lourdement leur message, au détriment de la subtilité.
- Quelques ruptures de ton : une ou deux séquences décalées peuvent troubler le public (notamment chez les plus jeunes).
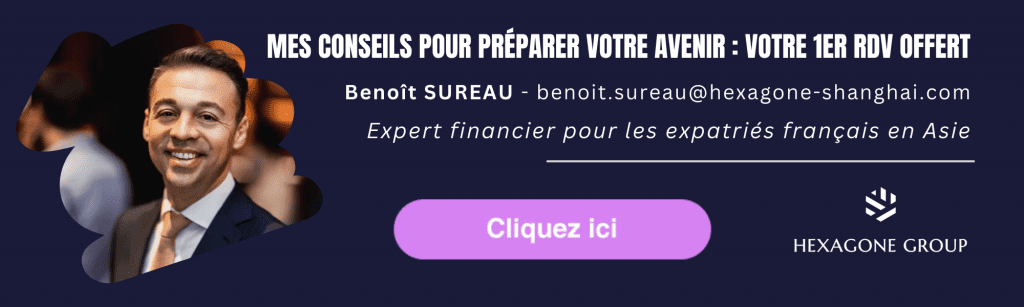
📰 En savoir ➕ 📰
Pour #approfondir et #compléter votre lecture, nous vous recommandons de découvrir les articles suivants :
- ⏯ On Happiness Road Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
- ⏯ Conseils aux touristes Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
- ⏯ Marché de la cosmétique à Taïwan Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
🤝 Programme d’affiliation 🤝
📌 Certains liens de cet article, ainsi que certaines images, renvoient vers des liens sponsorisés, permettant à Insidetaiwan.net de toucher une commission en cas d’achat, sans aucun coût supplémentaire pour vous. 💰 Cela nous aide à financer le magazine et à continuer à vous offrir un contenu indépendant et de qualité. 📖✨
💞 Soutenez-nous 💞
- ⏯ Nous soutenir #financièrement
- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters
- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux
- ⏯ Devenir #partenaire
- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu
- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)
Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.