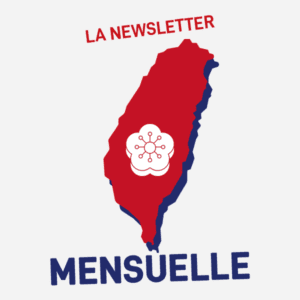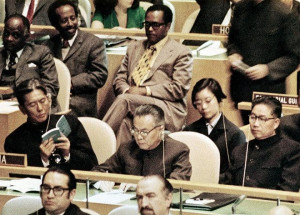Pendant des siècles, les peuples autochtones de Taïwan ont opposé une farouche résistance aux diverses puissances coloniales venues dominer l’île. Bien avant l’établissement de colonies permanentes, les tribus taïwanaises défendaient déjà leur territoire contre les incursions étrangères : en 1616, par exemple, une tentative d’implantation japonaise fut repoussée par les Aborigènes locaux. Par la suite, que ce soit face aux Hollandais au XVIIème siècle, aux autorités chinoises (dynastie Qing) aux XVIIIème/XIXème siècles ou aux Japonais au XXème siècle, les Austronésiens de Taïwan se sont soulevés à plusieurs reprises pour défendre leur autonomie et leurs modes de vie traditionnels.
1635-1636 : Révolte autochtone contre la colonisation hollandaise
En 1624, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales établit une base à Taïwan et tente d’étendre son contrôle sur les villages autochtones du sud-ouest de l’île. Les relations se dégradent rapidement : les indigènes supportent mal les exactions des colons et s’organisent pour défendre leurs terres. Des attaques contre les Hollandais éclatent dans la région de Tayouan (actuelle Tainan). Ainsi, dès 1629, les guerriers du village de Mattau tendent une embuscade et massacrent 60 soldats néerlandais près de Sincan. Ces affronts répétés convainquent le gouverneur hollandais qu’une action militaire d’envergure est nécessaire pour mater la résistance autochtone.
En 1635, les Hollandais lancent une « campagne de pacification » visant à soumettre les villages rebelles du sud-ouest de Taïwan. Mieux armées et disposant de renforts envoyés depuis Batavia, les troupes coloniales attaquent successivement les communautés indigènes les plus hostiles. Mattau, considéré comme le chef de file de la révolte, est pris d’assaut et sa population décimée en représailles de l’embuscade de 1629. D’autres villages alentour, tels Baccluan et Soulang, sont également vaincus militairement l’un après l’autre. Face à la puissance de feu néerlandaise, les chefs aborigènes comprennent qu’ils ne peuvent l’emporter. En février 1636, représentants et anciens de vingt-huit villages autochtones se rassemblent à Tayouan, au pied du fort Zeelandia, pour faire la paix et reconnaître la souveraineté hollandaise sur leurs terres.
La révolte autochtone de 1635-1636 se solde par la soumission forcée d’une grande partie des villages du sud-ouest taïwanais. Les Hollandais assoient dès lors leur contrôle sur les plaines côtières, s’assurant du même coup le monopole du commerce de peaux de cerf et de produits agricoles échangés avec les tribus. Les missionnaires protestants profitent de l’accalmie pour intensifier l’évangélisation et l’acculturation des peuples indigènes de la région. Cependant, cette paix coloniale reste précaire : nombre d’Aborigènes n’acceptent qu’en surface l’autorité néerlandaise et attendent l’occasion de se révolter de nouveau. En 1661, plusieurs tribus choisiront d’ailleurs de soutenir l’aventurier Koxinga dans son expulsion des Hollandais, espérant ainsi échapper à l’emprise européenne. La résistance de 1635-1636 inaugure donc une longue tradition de soulèvements autochtones face aux pouvoirs étrangers à Taïwan.
1731-1732 : Révolte de Ta-Chia-Xi (soulèvement des Taokas sous les Qing)
Sous l’administration de la dynastie Qing (qui annexe Taïwan en 1684), les populations autochtones des plaines occidentales subissent une pression accrue. Les autorités chinoises prélèvent impôts et corvées sur les “barbares apprivoisés” (villages autochtones sinisés), tandis que les colons Han empiètent de plus en plus sur les terres de chasse et de culture des indigènes. Dans les années 1720, les abus liés aux travaux forcés (corvées) exacerbent les tensions. En 1731, le peuple Taokas du secteur de Dajia (centre-ouest de Taïwan) se soulève contre l’administration Qing pour protester contre ces exactions. Rapidement, la rébellion s’étend : d’autres groupes autochtones des plaines rejoignent la révolte, formant une alliance multitribale. Les insurgés, estimés à plusieurs milliers de guerriers, prennent les armes et marchent vers le sud, attaquant les symboles du pouvoir chinois sur leur passage. Ils assiègent même la ville fortifiée de Changhua, centre administratif de la région.
Pendant plusieurs mois, les troupes Qing locales peinent à contenir l’insurrection Taokas. Les rebelles connaissent bien le terrain et bénéficient de l’effet de surprise. Face à l’ampleur du soulèvement, les autorités mandchoues dépêchent des renforts depuis le sud de l’île. En 1732, l’armée impériale, appuyée par la tribu autochtone An-li (rivale des Taokas restée fidèle aux Qing), lance l’offensive décisive. Pris en étau, les insurgés reculent des plaines vers les contreforts montagneux. La répression est féroce : villages incendiés, exécutions massives et décapitations symboliques. D’après les chroniques, pas moins de cinq groupes ethniques autochtones distincts avaient uni leurs forces dans la rébellion. Malgré cette alliance inédite, la supériorité des armements chinois et la trahison de certaines tribus opportunistes conduisent à l’échec de la révolte à la fin de l’année 1732.
La révolte de Ta-Chia-Xi (1731-1732) est l’un des soulèvements autochtones les plus importants de l’époque Qing à Taïwan. Sa répression sanglante entraîne des pertes très lourdes chez les indigènes rebelles (les récits font état de plusieurs milliers de morts) et la capture de nombreux chefs tribaux. Ébranlées par cette guerre, les autorités Qing prennent des mesures pour éviter de nouveaux affrontements de grande ampleur. Constatant la violence endémique à la frontière colonisée, l’empereur décide de confiner les populations aborigènes hors d’atteinte des colons Han. En 1739, une ligne de démarcation interne est établie à Taïwan : au-delà de ces stèles frontalières, l’accès aux territoires des “sauvages non soumis” est interdit aux Chinois. Cette politique du laisser-faire vise à prévenir les conflits en séparant physiquement colons et indigènes. Si elle limite temporairement les heurts, elle consacre aussi la marginalisation territoriale des autochtones. Malgré l’échec de 1732, la révolte des Taokas aura donc poussé le régime Qing à reconnaître l’importance de la question autochtone dans la gestion de l’île. Les plaines étant désormais largement contrôlées par les Han, la résistance autochtone se repliera dans les zones montagneuses, en attendant le prochain défi lancé aux colonisateurs.
1871-1874 : L’« incident de Mudan » (massacre de Mudan et expédition japonaise)
Au XIXème siècle, Taïwan reste en grande partie en dehors des circuits de la colonisation industrielle, mais les regards extérieurs commencent à se tourner vers l’île. En décembre 1871, un événement dramatique met en lumière la présence des populations autochtones aux yeux des puissances voisines. Cette année-là, un bateau en provenance du royaume de Ryūkyū (vassal à la fois de la Chine Qing et du Japon) fait naufrage sur les côtes sud de Taïwan. Cinquante-quatre marins ryukyuans échappent au naufrage et débarquent près du village autochtone de Mudan, dans le pays Paiwan. Par incompréhension culturelle ou méfiance, les villageois Paiwan finissent par massacrer ces 54 étrangers qu’ils perçoivent comme une menace. Douze survivants seulement, secourus par des Chinois locaux, réussissent à regagner Okinawa par la suite. Ce massacre des naufragés (connu plus tard sous le nom d’affaire de Mudan) crée un incident diplomatique immédiat entre le Japon et la Chine.
Le gouvernement japonais de l’ère Meiji voit dans l’affaire de Mudan un prétexte idéal pour intervenir militairement à Taïwan. Officiellement, Tokyo entend « punir » les indigènes responsables de la mort de ressortissants d’un royaume sous sa protection (les Ryūkyū). En réalité, il s’agit d’une première projection de force visant à tester la réaction de l’empire Qing et à asseoir l’influence japonaise dans la région. En 1874, une expédition punitive de trois mille soldats japonais, équipée de matériel moderne, débarque dans le sud de Taïwan. Les troupes impériales, menées par le commandant Saigō Tsugumichi, avancent vers les villages Paiwan de la zone de Mudan. De violents accrochages ont lieu : les guerriers autochtones opposent une résistance courageuse sur leur terrain escarpé, infligeant des pertes aux Japonais grâce à des tactiques de guérilla. Mais face à la puissance de feu supérieure et à la discipline de l’armée ennemie, les villages ne peuvent tenir longtemps. Plusieurs campements paiwan sont incendiés et leurs récoltes détruites en guise de représailles. Après quelques mois de confrontations sporadiques et d’épidémies touchant les rangs japonais, Tokyo et Pékin engagent des négociations pour éviter une escalade.
L’incident de Mudan se conclut sur un accord précaire entre le Japon et la Chine Qing. Cette dernière, qui jusque-là affirmait ne pas exercer d’autorité sur les « sauvages » de l’intérieur de Taïwan, est forcée d’admettre son incapacité à protéger l’ensemble de l’île. En 1874, les Qing consentent à verser une indemnité au Japon pour couvrir les frais de l’expédition, tandis que les troupes japonaises se retirent du sud de Taïwan. Pour l’empire Qing, la leçon est rude : laissé à l’écart, l’intérieur montagneux de Formose est devenu une faiblesse stratégique. Dès 1875, les autorités chinoises abolissent la frontière intérieure instaurée un siècle plus tôt et lancent des programmes de « pacification » des territoires autochtones, afin d’affirmer leur souveraineté sur toute l’île. Ironiquement, l’intervention japonaise aura donc poussé les Qing à occuper les terres des Aborigènes qu’ils avaient jusque-là dédaignées.
Sur le plan international, l’affaire de Mudan marque un tournant. C’est la première expédition militaire japonaise sur le sol taïwanais, préfigurant l’appétit impérial du Japon pour l’île. Vingt ans plus tard, en 1895, Taïwan sera cédée au Japon, et l’administration coloniale nipponne se souviendra de la « sauvagerie » rencontrée à Mudan pour justifier une politique répressive à l’égard des Aborigènes. Au Japon, l’incident de Mudan servit aussi de justification à l’annexion complète du royaume des Ryūkyū en 1879, les naufragés massacrés étant issus de cette région. Pour les Paiwan de Taïwan, les combats de 1874 se soldèrent par des pertes humaines et matérielles sévères, mais cet épisode reste dans la mémoire autochtone comme un acte de défense légitime du territoire face à un envahisseur étranger.
1915 : La révolte de Tapani contre l’occupation japonaise
Après l’annexion de Taïwan par le Japon en 1895, le régime colonial impose des mesures drastiques aux habitants de l’île, qu’ils soient Han ou autochtones. L’exploitation économique bat son plein (monopole sur l’industrie du camphre, confiscation de terres) et la police japonaise réprime durement toute contestation. Dans ce contexte, un important mouvement insurrectionnel éclate en 1915 dans le sud de Taïwan, connu sous le nom de révolte de Tapani. Ce soulèvement trouve son origine à la fois dans la colère accumulée contre les oppresseurs japonais et dans l’essor d’une secte millénariste locale. Sous la direction de Yu Qingfang, un chef religieux charismatique, des centaines de paysans Han et de guerriers autochtones (notamment du groupe Taivoan, issu des aborigènes des plaines) se rallient à l’idée d’une guerre sainte contre l’occupant. Les insurgés croient bénéficier de protections surnaturelles les rendant invincibles face aux balles, une conviction entretenue par les prêches de Yu Qingfang. Cette ferveur mystique, combinée à l’exaspération bien réelle de la population, sert de détonateur à l’une des plus vastes révoltes anti-japonaises de la période coloniale.
La révolte de Tapani débute en juillet 1915 par des attaques coordonnées contre les symboles du pouvoir colonial. Aux cris de ralliement de « Vive le roi Ming! » (référence à la dynastie chinoise déchue, populaire dans le folklore local), les insurgés prennent d’assaut plusieurs postes de police et bureaux administratifs dans la région de Tainan. Munis d’armes blanches, de fusils de chasse artisanaux et forts de leur foi en l’aide divine, ils parviennent initialement à surprendre les autorités. Durant quelques jours, plusieurs villages de l’arrière-pays passent sous le contrôle des rebelles, et des fonctionnaires japonais sont tués ou forcés de fuir. Cependant, la réaction de l’armée coloniale ne se fait pas attendre. Le gouverneur-général mobilise la gendarmerie et des renforts militaires qui convergent rapidement vers la zone insurgée. Supérieurs en nombre et en armement, les Japonais reprennent un à un les foyers de rébellion. Les combats font rage pendant deux semaines, mais face aux mitrailleuses et à l’artillerie, la révolte est progressivement étouffée.
Yu Qingfang est capturé avec ses principaux lieutenants. D’après les archives coloniales, plus de 1000 insurgés auraient été tués ou arrêtés pendant l’opération de répression, dont de nombreux Autochtones Taivoan engagés dans le soulèvement. La tête pensante de la rébellion, Yu Qingfang, est exécutée en public pour l’exemple, marquant la fin de la révolte de Tapani d’un point de vue militaire.
La sanglante répression de 1915 anéantit l’espoir d’une libération immédiate du joug japonais. La révolte de Tapani restera la dernière grande insurrection armée impliquant la population han de Taïwan contre les Japonais. Après 1915, toute résistance organisée des Taïwanais Han est pratiquement inexistante, découragée par l’ampleur des représailles et le renforcement du contrôle policier. En revanche, du côté des peuples autochtones, la lutte n’est pas terminée : la colonisation japonaise n’a pas encore pénétré certaines régions montagneuses du centre et de l’est, où les tribus aborigènes conservent une relative autonomie. Comme le note les historiens, « les autochtones continuèrent la lutte armée violente contre les Japonais tandis que les Han avaient cessé toute opposition violente après Tapani ».
Sur le plan colonial, l’incident de Tapani alerte Tokyo sur les risques de soulèvements généralisés. Les autorités japonaises voient dans le fanatisme religieux des insurgés un parallèle inquiétant avec la rébellion des Boxers en Chine quinze ans plus tôt. En conséquence, l’administration coloniale redouble de vigilance : surveillance accrue des mouvements millénaristes locaux, censure, et renforcement de l’encadrement des populations rurales. Paradoxalement, ce traumatisme pousse aussi les Japonais à adopter une approche plus « pragmatique » dans les campagnes : certaines revendications paysannes sont prises en compte afin de désamorcer les tensions (allègement de taxes locales, programmes sanitaires, etc.). Néanmoins, pour les Aborigènes des zones encore indépendantes, la répression de Tapani est le signe que le gouvernement colonial n’hésitera pas à user de la force totale. Ces tribus non soumises vont donc préparer dans l’ombre leur propre soulèvement, aboutissant quinze ans plus tard à l’événement le plus célèbre de la résistance autochtone taïwanaise : la révolte de Wushe.
1930 : L’incident de Wushe (révolte des Seediq contre le Japon)
À la fin des années 1920, Taïwan est entièrement placée sous domination japonaise depuis plus de trente ans. Si la plupart des régions sont pacifiées, les Aborigènes des hautes montagnes centrales subissent une oppression constante : spoliation de leurs terres forestières (pour l’exploitation du bois et du camphre), travail forcé, interdiction de nombreuses pratiques culturelles et présence intrusive de la police coloniale. La tribu Seediq (groupe Atayal) du secteur de Wushe, dans le massif central, ressent particulièrement ces humiliations quotidiennes. Son chef respecté, Mona Rudao (appelé aussi Mouna Rudo), a vu son peuple réduit au silence et à la pauvreté. En octobre 1930, une série d’incidents attise la colère des Seediq, en particulier un affront infligé par des policiers japonais lors d’une fête locale, et convainc Mona Rudao qu’il est temps de lancer une rébellion planifiée. Ayant secrètement uni six clans Seediq voisins, il choisit le moment opportun d’un grand rassemblement sportif où de nombreux officiels japonais seront présents, pour frapper un coup décisif.
Le 27 octobre 1930, à l’aube, les guerriers seediq passent à l’action lors des Jeux athlétiques de l’école de Musha (Wushe). Armés d’épées, de lances et de quelques fusils de chasse, ils fondent sur la foule et attaquent sans distinction les Japonais présents. L’effet de surprise est total : en quelques heures, 134 Japonais (principalement des hommes de l’administration coloniale, ainsi que des femmes et des enfants assistant à l’événement) sont tués par les insurgés, qui coupent routes et lignes télégraphiques. Cet assaut spectaculaire, le plus meurtrier qu’aient connu les Japonais à Taïwan, jette un coup de projecteur brutal sur la colère autochtone longtemps ignorée.
La réaction du gouvernement général japonais est immédiate. Des renforts militaires considérables sont envoyés dans la région de Wushe. L’armée coloniale, équipée de mortiers et d’avions, encercle les zones de forêts épaisses où se sont retranchées les familles Seediq. Commence alors une campagne de répression d’une rare violence. Les Japonais n’hésitent pas à recourir à des méthodes extrêmes : bombardements aériens des hameaux rebelles, épandage de gaz toxiques dans les grottes où la population s’abrite, et incendie systématique des villages insurgés. De plus, les autorités mobilisent d’autres tribus autochtones locales (notamment d’anciens rivaux des Seediq) pour former des milices collaboratrices chargées de traquer les rebelles, une stratégie de « diviser pour régner » déjà éprouvée. Pendant plus d’un mois, Mona Rudao et ses hommes résistent en menant des escarmouches dans la montagne, mais la disproportion des forces est insurmontable. À court de vivres et de munitions, et refusant de se rendre, beaucoup de Seediq choisissent de se suicider selon leurs coutumes guerrières plutôt que de tomber aux mains de l’ennemi. Mona Rudao lui-même met fin à ses jours peu avant l’issue finale. En tout, environ 644 Aborigènes (combattants et civils) trouvent la mort lors de la répression de Wushe.
L’incident de Wushe de 1930 est la dernière grande révolte autochtone armée de l’histoire taïwanaise, et son retentissement fut considérable. Du côté japonais, la brutalité de la répression a choqué jusqu’à Tokyo : l’opinion publique et certains parlementaires critiquent la manière dont le gouverneur de Taïwan a « géré » l’affaire, déplorant l’usage de gaz asphyxiants contre des sujets de l’Empire. Ébranlées, les autorités coloniales opèrent alors un revirement stratégique vis-à-vis des indigènes. Constatant que la seule terreur militaire alimente le ressentiment, le pouvoir japonais décide après 1930 de miser sur l’assimilation des peuples autochtones restants. Concrètement, cela se traduit par une série de réformes : intensification de l’enseignement du japonais dans les communautés montagnardes, conversion forcée des modes de vie (les jeunes autochtones sont encouragés à rejoindre l’armée ou la police coloniale), et abandon officiel du vocabulaire péjoratif. En 1935, le terme injurieux de banjin (« sauvages ») est abandonné par l’administration, qui lui substitue l’expression Takasago-zoku (« tribus de Takasago ») pour désigner l’ensemble des Aborigènes de Taïwan. Cette évolution sémantique s’accompagne d’une propagande présentant désormais les indigènes comme des sujets impériaux à part entière, valeureux et loyaux envers l’Empereur. D’ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs centaines de jeunes aborigènes furent enrôlés comme volontaires Takasago dans l’armée japonaise, un fait impensable quelques années auparavant.
Pour les Seediq et les autres peuples autochtones taïwanais, l’héritage de Wushe est double. D’une part, la défaite sanglante de 1930 marque la fin de toute résistance armée ouverte contre un pouvoir colonial à Taïwan, plus jamais les indigènes ne prendront les armes de cette manière. D’autre part, le sacrifice de Mona Rudao et de ses combattants devient un symbole puissant de la résistance à l’oppression. Malgré la volonté initiale des autorités japonaises d’étouffer l’affaire (censure de la presse, interdiction du souvenir), la mémoire de Wushe persistera dans les récits oraux autochtones et refera surface des décennies plus tard comme un épisode héroïque de l’histoire de Taïwan.
Héritage des révoltes autochtones dans la Taïwan contemporaine
Longtemps passés sous silence par les récits officiels, les soulèvements autochtones de Taïwan font désormais l’objet d’une réévaluation historique et d’une commémoration active. Avec la démocratisation de l’île à la fin du XXème siècle, ces épisodes de résistance (occultés tant par le régime colonial japonais que par le pouvoir nationaliste chinois du XXème siècle) ont pu être revisités au grand jour. La mémoire de la révolte de Wushe, en particulier, a connu une renaissance symbolique : érection de statues de Mona Rudao, stèles et plaques commémoratives sur les anciens champs de bataille, musées locaux dédiés aux « guerriers de l’arc-en-ciel ». Dans les années 2000, la sortie du film Seediq Bale (2011) retraçant l’incident de Wushe a touché un large public, inscrivant cet événement dans la conscience nationale populaire. Plus généralement, les cinq grandes révoltes autochtones évoquées dans cet article sont aujourd’hui reconnues comme faisant partie intégrante de l’histoire de Taïwan, au même titre que les soulèvements des Han contre la corruption ou l’oppression. Elles symbolisent la contribution des premiers habitants de l’île à la défense de sa liberté et de son identité face aux colonisations successives.
Par ailleurs, cet héritage mémoriel a contribué à faire évoluer le regard de la société taïwanaise sur les peuples indigènes. Les gouvernements récents ont multiplié les gestes de reconnaissance : en 2016, la présidente Tsai Ing-wen a présenté des excuses officielles aux Aborigènes pour des siècles d’injustices, et des mesures ont été prises pour la restitution de terres et la protection des langues autochtones. La célébration des résistances passées s’inscrit ainsi dans une redéfinition multiculturelle de l’identité taïwanaise. Toutefois, des défis subsistent. Certains observateurs pointent une tendance à la folklorisation des Autochtones (on les met en valeur lors d’événements officiels, sans toujours aborder franchement les violences historiques qu’ils ont subies). De même, une partie du grand public méconnaît encore l’ampleur des spoliations et des combats endurés par ces communautés.
Néanmoins, la transmission actuelle de la mémoire des grandes révoltes autochtones constitue un pas essentiel vers une meilleure compréhension de l’histoire taïwanaise dans toute sa complexité. En honorant la résilience des peuples autochtones, Taïwan redécouvre une part de son héritage national longtemps marginalisée. Ces cinq soulèvements, de la résistance aux Hollandais au XVIIème siècle jusqu’à l’ultime baroud d’honneur face aux Japonais en 1930, rappellent que l’esprit de liberté et de résistance fait partie intégrante de l’âme taïwanaise, forgée dans la diversité de ceux qui ont habité et défendu cette île à travers les âges.
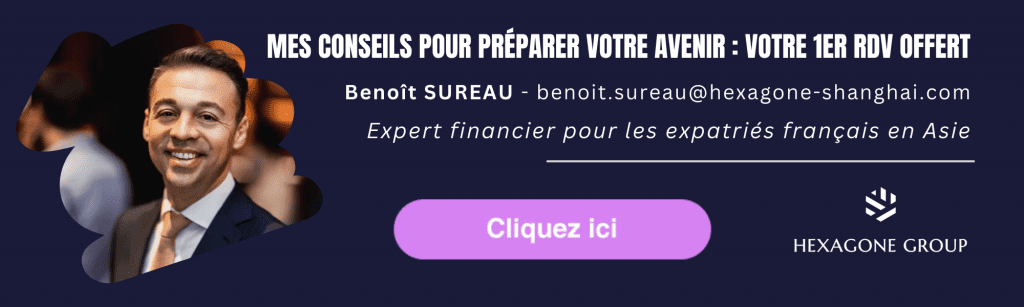
📰 En savoir ➕ 📰
Pour #approfondir et #compléter votre lecture, nous vous recommandons de découvrir les articles suivants :
- ⏯ Les Premiers Habitants de Taïwan Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
- ⏯ Evolution des noms des aborigènes de Taïwan Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
- ⏯ La révolte de Lin Shuangwen Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
🤝 Programme d’affiliation 🤝
📌 Certains liens de cet article, ainsi que certaines images, renvoient vers des liens sponsorisés, permettant à Insidetaiwan.net de toucher une commission en cas d’achat, sans aucun coût supplémentaire pour vous. 💰 Cela nous aide à financer le magazine et à continuer à vous offrir un contenu indépendant et de qualité. 📖✨
💞 Soutenez-nous 💞
- ⏯ Nous soutenir #financièrement
- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters
- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux
- ⏯ Devenir #partenaire
- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu
- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)
Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.