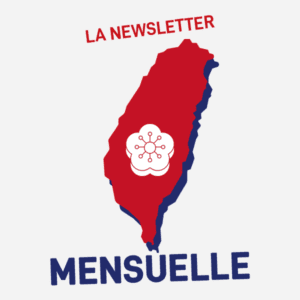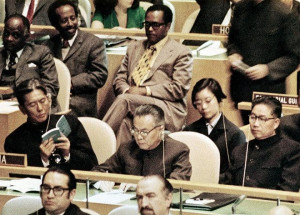En mars 2014, Taïwan a été le théâtre d’un mouvement de protestation sans précédent, connu sous le nom du Mouvement des Tournesols des étudiants (simplifié en Mouvement des Tournesols, ou Mouvement 318, en chinois 太陽花學運). Pendant près d’un mois, des étudiants et des militants ont occupé le Parlement taïwanais pour s’opposer à un accord commercial controversé avec la Chine. Ce vaste soulèvement populaire, symbolisé par la fleur de tournesol, a marqué un tournant dans la jeune démocratie taïwanaise. Il s’est déroulé sur fond de relations sensibles entre Taipei et Pékin, a mobilisé des dizaines de milliers de citoyens et suscité un intense débat national. Plus d’une décennie plus tard, son héritage politique et social reste perceptible.

Contexte historique et politique
Pour comprendre le Mouvement des Tournesols, il faut d’abord situer le contexte des relations entre la Chine et Taïwan au début des années 2010. Depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, Taïwan (République de Chine) revendique son autonomie vis-à-vis de Pékin (République populaire de Chine), qui considère l’île comme une province rebelle. Après des décennies de tension, les années 2008-2014 voient un rapprochement économique entre les deux rives du détroit de Taïwan. Le président taïwanais de l’époque, Ma Ying-jeou, du parti Kuomintang (KMT, nationaliste), mise sur des accords commerciaux pour renforcer les liens avec la Chine continentale et stimuler l’économie insulaire.
C’est dans ce cadre qu’est signé en juin 2013 un Accord sur le commerce des services entre Taïwan et la Chine (souvent appelé pacte commercial ou CSSTA). L’accord vise à ouvrir mutuellement des dizaines de secteurs de services à l’investissement : il prévoit d’ouvrir 80 secteurs chinois aux entreprises taïwanaises et 64 secteurs taïwanais aux entreprises chinoises. Le gouvernement Ma Ying-jeou vante ce pacte comme une opportunité économique essentielle, étant donné le poids de la Chine, premier marché d’exportation de l’île.

Cependant, une partie importante de la population s’inquiète des effets de cet accord. Fin 2013 et début 2014, des voix s’élèvent pour réclamer plus de transparence et un examen détaillé du pacte au Parlement. L’opposition craint que l’ouverture du marché taïwanais aux grands capitaux chinois ne fragilise les petites entreprises locales, pilier de l’économie de l’île. Des secteurs sensibles comme les télécommunications, les transports ou les médias pourraient passer sous influence de Pékin, avec des conséquences potentielles sur les libertés publiques. Plus largement, de nombreux Taïwanais redoutent qu’une intégration économique trop poussée ne donne à Pékin un levier politique pour accroître son emprise sur Taïwan. Ces craintes sont nourries par l’exemple de Hong Kong : bien qu’autonome, l’ex-colonie britannique voit sa liberté d’expression reculer sous la pression de Pékin, un scénario que les Taïwanais veulent éviter à tout prix.
Au Parlement taïwanais (le Yuan législatif), l’examen du pacte de services tourne à l’affrontement politique en mars 2014. Le KMT, majoritaire, souhaite faire adopter rapidement l’accord, tandis que le Parti démocrate progressiste (DPP, opposition) exige un examen article par article et des auditions publiques. Le 17 mars 2014, à l’issue d’une commission parlementaire chaotique, un député du KMT annonce soudainement que le texte sera transmis en séance plénière sans plus de débats, s’appuyant sur un règlement obscure. Pour l’opposition, c’est un passage en force inacceptable. Cette manœuvre de dernière minute, perçue comme un déni de démocratie et de transparence, est l’élément déclencheur de la mobilisation étudiante.
Les événements clés de mars-avril 2014
Le 18 mars 2014, dès le lendemain de la décision contestée en commission, la colère étudiante éclate. Le soir même, des centaines d’étudiants et militants envahissent l’hémicycle du Yuan législatif à Taipei, le Parlement national. C’est la première fois dans l’histoire de Taïwan que des citoyens occupent ainsi le Parlement. Les jeunes manifestants barricadent les entrées avec des chaises et des tables, tandis que des milliers de sympathisants se rassemblent à l’extérieur pour les soutenir. Sur les lieux, un fleuriste distribue spontanément des tournesols, symboles d’espoir, aux manifestants, donnant son nom au mouvement. Le Mouvement 318 (surnommé ainsi d’après la date du 18 mars) ou Occupy Parliament s’organise rapidement : les étudiants établissent des équipes pour la sécurité, la logistique, la communication et nettoient les lieux régulièrement. L’occupation se veut pacifique et civique, les protestataires prenant soin de préserver le matériel et les documents parlementaires.

Les premiers jours, la tension est palpable. Le gouvernement dépêche des unités de police anti-émeute autour du Parlement, mais évite initialement un assaut frontal qui risquerait d’enflammer la situation. À l’intérieur, les étudiants formulent leurs revendications et appellent au soutien populaire. Très vite, le mouvement gagne en ampleur. Des assemblées citoyennes et des concerts improvisés ont lieu aux abords du Parlement et transforment le quartier en véritable forum politique à ciel ouvert. Des bénévoles de tous horizons apportent de la nourriture, de l’eau, des médicaments, tandis que des avocats et des ONG se mobilisent pour conseiller les occupants sur leurs droits. Les réseaux sociaux et une retransmission vidéo en continu depuis l’hémicycle permettent de médiatiser le mouvement en temps réel dans tout le pays.
Le 23 mars 2014, un événement marque un tournant: tard dans la soirée, un groupe dissident de manifestants, mené par l’activiste Wei Yang, tente d’occuper le siège du gouvernement, le Yuan exécutif (bureau du Premier ministre). Ils organisent un sit-in sur le parvis puis forcent l’entrée de l’édifice. Cette fois, la réaction des autorités est immédiate et musclée. Aux premières heures du 24 mars, la police anti-émeute évacue violemment les intrus du Yuan exécutif et utilise des matraques et des canons à eau. L’opération fait des dizaines de blessés parmi les protestataires, images à l’appui, et provoque l’indignation d’une partie de l’opinion. 21 personnes, dont Wei Yang, sont arrêtées et inculpées (pour occupation illégale, dégradation et incitation à l’émeute). Cette répression, bien que circonscrite au seul bâtiment du gouvernement, renforce la détermination des étudiants retranchés au Parlement. Elle élargit aussi la sympathie du public à leur égard, beaucoup perçoivent alors, les manifestants comme des jeunes idéalistes victimes de brutalités.
Le 30 mars 2014, le mouvement atteint son apogée. En signe de solidarité avec les occupants du Parlement, une gigantesque manifestation est organisée à Taipei. Ce jour-là, entre 350 000 et 500 000 personnes défilent pacifiquement dans le centre-ville, notamment sur l’avenue Ketagalan devant le palais présidentiel. C’est l’une des plus grandes mobilisations de l’histoire récente de Taïwan. Des familles entières, des travailleurs, des retraités rejoignent les étudiants pour dire non au pacte avec Pékin et défendre la souveraineté de l’île. Parmi les manifestants se trouvent des figures politiques de l’opposition, dont Tsai Ing-wen (chef du DPP et future présidente) qui déclare ne pas vouloir que « Taïwan devienne un deuxième Hong Kong ». L’ancien président Lee Teng-hui, artisan de la démocratisation de Taïwan, salue également la « vitalité de la démocratie taïwanaise » démontrée par la jeunesse. La mer de manifestants brandissant des tournesols envoie un message clair au pouvoir en place et aux médias du monde entier.
Face à cette pression populaire croissante, le président Ma Ying-jeou reste d’abord inflexible. Il réitère l’importance du pacte commercial pour l’économie et invite les étudiants au dialogue, tout en excluant tout retrait du texte. Toutefois, en coulisses, les dissensions apparaissent au sein même du camp au pouvoir. Wang Jin-pyng, le président (KMT) du Parlement, en froid avec Ma Ying-jeou sur des querelles internes, adopte une posture conciliante envers les manifestants. Ce calcul politique va s’avérer décisif pour une issue pacifique.

Après plus de trois semaines d’occupation, un compromis est finalement trouvé. Le 10 avril 2014, en fin de journée, les leaders étudiants annoncent qu’ils mettront fin à l’occupation du Parlement. Cette décision fait suite à une intervention directe du président du Parlement, Wang Jin-pyng, venu rencontrer les manifestants dans l’hémicycle. Celui-ci s’engage publiquement à suspendre l’examen du pacte avec la Chine et à faire voter au préalable une loi instaurant un mécanisme de supervision parlementaire de tout accord futur avec Pékin. Cet engagement répond à l’une des exigences clés du mouvement. Devant cette victoire obtenue sans violence, les étudiants peuvent clamer victoire. Le soir du 10 avril, dans une ambiance mêlant joie et émotion, les jeunes évacuent tranquillement les locaux après avoir nettoyé de fond en comble l’hémicycle occupé. Brandissant une dernière fois des tournesols, ils quittent le Parlement sous les applaudissements de la foule massée à l’extérieur. L’occupation aura duré 24 jours au total (un record) et s’achève donc sans bain de sang, fait notable en comparaison d’autres mouvements d’occupation à travers le monde.
Revendications des manifestants et opposition au pacte
Dès le début de l’occupation, les manifestants affichent clairement leurs revendications principales. Elles s’articulent autour de deux axes majeurs : le refus du pacte commercial tel qu’il a été négocié et l’exigence de davantage de transparence démocratique dans le processus de ratification des accords avec la Chine.
- Rejet du pacte commercial avec la Chine (CSSTA) : les protestataires demandent l’abandon pur et simple, ou à minima la renégociation, de l’accord de libre-échange des services sino-taïwanais. À leurs yeux, ce pacte menace l’économie et la sécurité de Taïwan. Ils estiment qu’en ouvrant des secteurs entiers aux investissements chinois (banque, télécoms, santé, édition, transport, etc.), l’accord exposerait l’île aux ingérences de Pékin et au dumping économique. Le slogan fréquemment entendu « Aujourd’hui Hong Kong, demain Taïwan » résume la crainte d’une perte progressive de contrôle sur les secteurs stratégiques et, in fine, d’une érosion de la démocratie taïwanaise. Certains opposants n’hésitent pas à parler de « vente de Taïwan à la Chine » pour décrire ce pacte jugé trop favorable aux grands groupes chinois. Par ailleurs, les étudiants font valoir que 75 % de la population s’oppose à l’accord dans sa forme actuelle, selon des sondages publiés à l’époque. Ils se considèrent donc comme les porte-voix d’une majorité silencieuse inquiète pour l’avenir de la nation.
- Mécanisme démocratique de supervision des accords avec Pékin : au-delà du cas spécifique du CSSTA, le Mouvement des Tournesols formule une demande institutionnelle forte. Les étudiants réclament l’adoption d’une loi cadre de surveillance des accords inter-détroit (Chine/Taïwan). Concrètement, il s’agirait de soumettre tout futur traité avec la Chine à une procédure transparente : examen article par article au Parlement, consultations de la société civile, et possibilité pour les citoyens de peser dans les négociations. Cette revendication émane du constat que le pacte de services a été négocié de facto dans l’opacité par l’exécutif, puis brusquement présenté au vote sans débat. Les manifestants y voient un dangereux précédent où le pouvoir en place pourrait « engranger des accords qui bradent la liberté » sans contre-pouvoir. L’obtention par les protestataires, le 10 avril 2014, de la promesse d’un examen législatif préalable (loi de supervision) est ainsi perçue comme une victoire majeure répondant à cette exigence de démocratie participative.

En synthèse, le Mouvement des Tournesols ne rejette pas la coopération économique avec la Chine de manière absolue, mais exige qu’elle ne se fasse pas au détriment de la souveraineté de Taïwan ni dans le dos du peuple taïwanais. Le cœur du message est la défense de la démocratie face à un voisin chinois puissant : “Si nous ne nous battons pas nous-mêmes pour notre démocratie, personne ne le fera à notre place”, clament en substance les étudiants. Ils inscrivent leur combat dans la continuité de la lutte historique de Taïwan pour sa liberté, évoquant le mouvement étudiant des Lys Sauvages de 1990 qui avait déjà fait avancer la démocratisation de l’île. Le tournesol, symbole choisi du mouvement, représente quant à lui la lumière de la transparence venant dissiper l’« opacité » des tractations avec Pékin.
Réactions de la société civile, des partis et des autorités
Le soulèvement des Tournesols a suscité des réactions multiples à Taïwan, révélé des clivages mais aussi une large implication citoyenne.
Dans la société civile, le mouvement a bénéficié d’un fort appui populaire. Outre la manifestation monstre du 30 mars, des sondages ont indiqué une opinion majoritairement favorable aux revendications étudiantes. Beaucoup de Taïwanais, en particulier les jeunes générations, se sont reconnus dans ce combat pour l’avenir de la démocratie de l’île. Des collectifs d’avocats, de médecins, d’artistes, d’universitaires se sont relayés pour apporter un soutien logistique ou moral aux occupants du Parlement. La mobilisation a également débordé hors de Taïwan : des rassemblements de solidarité ont eu lieu dans la diaspora taïwanaise, que ce soit à Hong Kong (où les militants pro-démocratie voyaient un parallèle avec leur propre situation naissante) ou dans des villes occidentales comme Paris, où une centaine de personnes se sont réunies au Trocadéro en soutien à la démocratie taïwanaise. Une telle sympathie s’explique par l’image largement pacifique et responsable renvoyée par les étudiants : pas de pillage ni saccage, une communication ouverte via les médias et réseaux sociaux, et des valeurs démocratiques universelles mises en avant. L’ancien président Lee Teng-hui, père de la démocratie taïwanaise, résume l’opinion de nombre d’observateurs en déclarant : « Nos jeunes ont montré au monde la vitalité de la démocratie de Taïwan ».

Sur la scène politique, les réactions ont suivi les lignes partisanes. Le KMT au pouvoir a dénoncé l’occupation parlementaire comme illégale et potentiellement chaotique. Le président Ma et son Premier ministre Jiang Yi-huah ont martelé que céder aux manifestants mettrait en péril la crédibilité de Taïwan auprès des investisseurs et de Pékin. Ils accusent même l’opposition d’orchestrer en sous-main le mouvement pour servir ses intérêts électoraux. Cependant, la marge de manœuvre du gouvernement s’est trouvée limitée par la popularité du mouvement. Au sein du KMT, une fracture est apparue : certains élus modérés craignent qu’une répression violente ne se retourne contre le parti. C’est ainsi que le président du Parlement, Wang Jin-pyng (lui-même du KMT mais rival politique de Ma), a adopté un ton compréhensif envers les étudiants, en refusant d’ordonner une expulsion par la force. Ce jeu interne affaiblit la position du gouvernement et ouvre la voie au compromis du 10 avril.
Du côté de l’opposition DPP, le mouvement des Tournesols est largement soutenu, bien qu’officiellement, le parti n’en soit pas l’initiateur. Les cadres du DPP, dont Tsai Ing-wen, multiplient les déclarations de sympathie et exhortent le gouvernement à écouter la jeunesse. Des députés d’opposition se rendent régulièrement aux abords du Parlement occupé, en servant d’interface entre étudiants et forces de l’ordre pour prévenir tout débordement. On observe néanmoins une certaine prudence du DPP à ne pas apparaître comme « récupérant » la protestation : conscient que la force du mouvement réside dans son caractère spontané et non partisan, le DPP évite de prendre le leadership et préfère agir en soutien discret. En coulisses, cependant, l’opposition voit dans cette crise une opportunité de mettre en difficulté le pouvoir et de rassembler les électeurs hostiles aux politiques pro-Pékin du KMT.
Les médias taïwanais ont consacré une couverture massive à l’événement. Les chaînes d’info en continu filment nuit et jour l’occupation, tandis que la presse écrite publie des éditoriaux enflammés, tantôt favorables aux étudiants, tantôt critiquant l’atteinte à l’ordre institutionnel. Les médias proches du KMT insistent sur le manque d’expérience des protestataires et les risques économiques d’un blocage du pacte. À l’inverse, des journaux plus indépendants ou pro-DPP saluent l’éveil démocratique de la jeunesse et dénoncent « l’opacité » du gouvernement dans la gestion des relations avec Pékin. Globalement, l’opinion publique a pu suivre le mouvement au jour le jour grâce à la diffusion en direct depuis l’enceinte parlementaire (une webcam retransmettait les assemblées des étudiants). Cette transparence médiatique a sans doute contribué à légitimer le mouvement auprès de l’opinion, en montrant des jeunes organisés, respectueux et formulant rationnellement leurs demandes.

Les autorités et institutions ont adopté des positions variées. La police, placée dans une situation délicate, a globalement fait preuve de retenue à l’égard des occupants du Parlement (aucune tentative de dispersion forcée de l’hémicycle pendant les 24 jours). En revanche, l’évacuation musclée du Yuan exécutif le 24 mars a terni l’image du gouvernement. Par la suite, la justice taïwanaise a été saisie pour statuer sur les éventuelles poursuites contre les leaders du mouvement. En première instance, plusieurs figures étudiantes ont été condamnées pour intrusion et obstruction aux fonctions publiques. Toutefois, ces verdicts ont évolué au fil des appels : finalement, en janvier 2021, la Cour suprême de Taïwan a cassé les condamnations restantes en invoquant le droit à la résistance inscrit dans l’ordre constitutionnel. Cette décision judiciaire majeure a reconnu implicitement la légitimité de la désobéissance civile des Sunflowers dans le contexte de la défense de la démocratie.
Conséquences politiques et institutionnelles à moyen et long terme
Le Mouvement des Tournesols a eu des répercussions profondes sur la vie politique taïwanaise les années suivantes. À court terme, son impact le plus tangible a été le blocage du pacte commercial avec la Chine. Comme promis, l’accord de services (CSSTA) n’a jamais été ratifié : il est resté en suspens au Parlement, puis a été mis de côté lorsque le pouvoir a changé en 2016. En parallèle, les discussions autour d’une loi de supervision des accords avec Pékin ont été lancées. Toutefois, la mise en place de ce mécanisme législatif a pris du retard. Malgré l’engagement de 2014, la loi-cadre de contrôle parlementaire des traités avec la Chine n’était toujours pas adoptée fin 2016, le projet se heurtant à des divergences partisanes et perdant de son urgence une fois le CSSTA enterré. Ce n’est que plusieurs années plus tard que la question a refait surface, sans aboutir pleinement selon certains analystes, ce qui montre que tous les acquis du mouvement n’ont pas été concrétisés institutionnellement.
En termes de dynamiques politiques internes, le mouvement a rebattu les cartes. Le KMT au pouvoir en est sorti considérablement affaibli. La gestion de la crise par le président Ma a été critiquée jusque dans son propre camp, et l’opinion publique lui en a tenu rigueur. Moins de huit mois après l’occupation, lors des élections locales de novembre 2014, le KMT a subi de lourds revers électoraux, en perdant plusieurs grandes villes (dont Taipei) au profit du DPP ou de candidats indépendants soutenus par l’opposition. Ces résultats ont été largement interprétés comme le reflet du mécontentement populaire suscité par la gouvernance du KMT et sa politique trop alignée sur Pékin, mise en lumière par le Mouvement des Tournesols. Le président Ma Ying-jeou a d’ailleurs dû démissionner de la tête du KMT après ce scrutin désastreux pour son parti.
La vague de fond s’est confirmée lors des élections générales de janvier 2016. Pour la première fois de l’histoire, le DPP a remporté non seulement la présidence de la République (avec l’élection de Tsai Ing-wen, devenue la première femme présidente de Taïwan), mais aussi la majorité absolue au Parlement. Cette alternance majeure, la seconde depuis la démocratisation, a été facilitée par la mobilisation citoyenne dont le mouvement étudiant a été l’un des catalyseurs. Nombre d’électeurs, en particulier les jeunes votants, se sont enregistrés et déplacés aux urnes, galvanisés par l’expérience politique de 2014. L’engagement de la jeunesse est l’un des legs directs des Tournesols, comme l’a analysé le politologue Stéphane Corcuff : « Ce mouvement a été un tournant, car rien de tel ne s’était jamais passé à Taïwan. (…) Au-delà du ras-le-bol vis-à-vis d’une gouvernance perçue comme autoritaire de la part du gouvernement Ma, de nouveaux facteurs entrent en jeu, notamment un renouveau de la mouvance indépendantiste, la volonté de la société civile de s’imposer dans les débats sur les relations avec la Chine et le réveil politique de la jeunesse ». Autrement dit, le Mouvement des Tournesols a libéré une énergie politique qui a perduré lors des scrutins suivants, en contribuant à faire pencher la balance en faveur des partis qui prônent une plus grande prudence vis-à-vis de Pékin.

Sur le plan institutionnel, la crise de 2014 a également entraîné des réflexions et des réformes. Ainsi, le Parlement taïwanais a depuis adopté des mesures pour accroître la transparence des processus législatifs, afin d’éviter qu’un examen expéditif comme celui du CSSTA ne se reproduise. Des discussions se sont tenues sur le renforcement du rôle de supervision du Yuan de Contrôle (organe de supervision gouvernemental) concernant les négociations sensibles. Par ailleurs, la notion de « droit à la résistance » invoquée par la Cour suprême en 2021 pour les activistes Sunflower a fait jurisprudence et nourrit le débat juridique sur la portée de la désobéissance civile dans un régime démocratique.
Enfin, le Mouvement des Tournesols a conduit à l’émergence de nouvelles forces dans le paysage politique. En 2015, des leaders et sympathisants du mouvement étudiant ont fondé de petits partis réformistes, qualifiés de « Troisième force » en dehors du duopole KMT-DPP. Le plus notable est le New Power Party (NPP), créé par de jeunes militants pro-démocratie (dont l’avocat Huang Kuo-chang et le chanteur Freddy Lim). Lors des élections législatives de 2016, le NPP a remporté cinq sièges, réussissant l’entrée de cette nouvelle génération au Parlement. D’autres formations progressistes (Parti Social-Démocrate, Parti Vert) ont également tenté de capitaliser sur l’élan citoyen de 2014. Toutefois, maintenir cet élan s’est avéré difficile : avec le temps, certaines de ces nouvelles voix ont perdu du terrain ou se sont fragmentées. Par exemple, le New Power Party n’a pas su répondre pleinement aux attentes et a vu son soutien décliner lors des élections suivantes. Néanmoins, le simple fait que des étudiants activistes de 2014 soient devenus élus (députés ou conseillers municipaux) témoigne d’un renouvellement partiel du personnel politique et d’une ouverture du système politique à des visages issus de la société civile.
L’héritage du mouvement en 2025 : qu’est-ce qui a changé, qu’est-ce qui reste ?
Plus de dix ans après les événements, l’héritage du Mouvement des Tournesols demeure visible à Taïwan, bien que nuancé. Qu’est-ce qui a changé depuis 2014 ? D’une part, la société taïwanaise a gagné en maturité politique. La génération qui s’est mobilisée à l’époque est aujourd’hui trentenaire, et beaucoup de ses membres sont restés actifs dans la vie publique. Plusieurs anciens leaders étudiants ont embrassé une carrière politique ou civique. Ainsi, Lin Fei-fan, l’un des visages emblématiques de l’occupation, est devenu une figure du DPP (il a notamment été nommé secrétaire adjoint du parti quelques années plus tard). Des militants comme Miao Po-ya, qui se réclame inspirée par les Tournesols, ont été élus conseillers municipaux à Taipei. À chaque élection depuis lors, on constate une participation accrue des jeunes électeurs, comparé à l’avant-2014, signe que le mouvement a éveillé une nouvelle conscience citoyenne chez la jeunesse. L’idée que s’engager en politique peut faire une différence s’est ancrée chez de nombreux jeunes Taïwanais, alors qu’avant 2014 le taux de participation des 20-30 ans était relativement faible.
D’autre part, Taïwan a poursuivi sa trajectoire démocratique en tenant Pékin à distance sur le plan politique. Depuis 2016, les gouvernements successifs (dirigés par le DPP) ont adopté une ligne prudente vis-à-vis de la Chine, en refusant notamment de relancer des accords d’intégration économique majeurs tant que Pékin n’offre pas de garanties suffisantes. La stratégie du “sud” a été privilégiée pour diversifier les partenariats économiques vers d’autres pays d’Asie du Sud-Est ou d’Amérique, en réduisant, ainsi, la dépendance commerciale vis-à-vis de la Chine. On peut estimer que le Mouvement des Tournesols a contribué à cette orientation en démontrant l’hostilité d’une partie de la population à un rapprochement inconsidéré avec la Chine. De fait, Taïwan a enregistré des succès économiques notables durant la décennie, sans s’aligner sur Pékin, en témoigne par exemple l’indice boursier taïwanais ayant franchi des sommets (20 000 points) tout en préservant l’autonomie politique de l’île. Comme le soulignait un conseiller municipal ancien du mouvement, « Taïwan a réussi à prospérer sans le pacte avec la Chine, ce qui prouve qu’un autre chemin était possible ».
Cependant, tout n’est pas rose en 2025 et certains aspects du mouvement relèvent désormais du souvenir plus que de la réalité active. Par exemple, la loi de supervision des accords avec la Chine, arrachée en promesse en 2014, a mis de longues années à être examinée et n’a été que partiellement mise en œuvre. Les mécanismes institutionnels de contrôle des négociations avec Pékin restent un sujet de débat, surtout à l’approche de chaque alternance politique. Aussi, la puissante vague citoyenne de 2014 n’a pas empêché un certain désenchantement politique de réapparaître chez une partie du public. Au fil des ans, l’attention des médias et du public s’est tournée vers d’autres enjeux (réformes internes, pandémie de Covid-19, menaces militaires chinoises accrues). Un ancien participant du mouvement notait qu’en 2014 les forums en ligne taïwanais bouillonnaient de discussions politiques passionnées, alors qu’aujourd’hui, le débat public semble parfois apathique et pollué par des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. En outre, les petits partis nés de la mouvance Sunflower, porteurs d’un grand espoir de renouveau, ont en partie déçu ou se sont marginalisés. Par exemple, le New Power Party, après des débuts prometteurs, a perdu de son lustre et n’a pas réussi à s’implanter durablement comme troisième force dominante. Lors des élections de 2024 il n’a d’ailleurs obtenu aucun députés… alors que le Parti du Peuple Taïwanais (TPP) en a obtenu 8.
Il n’en reste pas moins que l’esprit du Mouvement des Tournesols continue d’influencer la politique taïwanaise. Chaque fois que des débats surgissent sur les relations avec Pékin, l’ombre de 2014 refait surface dans l’argumentaire public. Les dirigeants actuels savent qu’une fraction importante de la population, notamment les moins de 40 ans, a été formée politiquement par cette expérience et restera vigilante face à toute initiative perçue comme bradant la souveraineté de l’île. L’héritage des Tournesols, c’est aussi la normalisation de l’activisme étudiant comme composante de la démocratie taïwanaise. En 2019, lorsque Hong Kong a connu à son tour un vaste mouvement pro-démocratie (Révolution des Parapluies puis mouvement anti-loi d’extradition), nombre de Taïwanais y ont vu un écho de leur propre lutte et ont soutenu activement le camp hongkongais, prolongeant ainsi la solidarité née en 2014.
En conclusion, le Mouvement des Tournesols de 2014 a été à la fois l’aboutissement de préoccupations latentes (face à l’influence chinoise grandissante) et le point de départ d’une nouvelle phase d’engagement citoyen. En 2025, Taïwan reste l’une des démocraties les plus vivantes d’Asie, et beaucoup attribuent en partie ce dynamisme à la génération Sunflower. Comme l’a proclamé l’un des leaders étudiants, Lin Fei-fan, en quittant le Parlement le 10 avril 2014 : « Nous allons poursuivre cette histoire, nous ne reculerons pas et n’abandonnerons jamais ». Plus d’une décennie plus tard, l’histoire lui donne en partie raison, sans triomphalisme excessif, l’esprit du Tournesol continue d’éclairer la trajectoire de Taïwan.

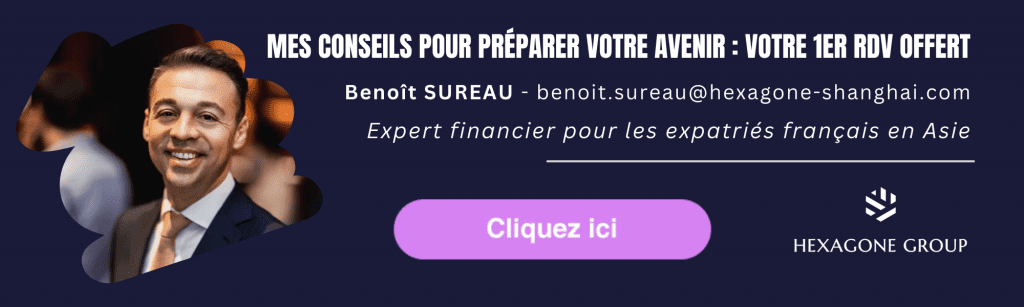
📰 En savoir ➕ 📰
Pour #approfondir et #compléter votre lecture, nous vous recommandons de découvrir les articles suivants :
- ⏯ Le mouvement Blue Bird, successeur des tournesols ? Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
- ⏯ 10 ans après le mouvement des Tournesols Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
- ⏯ Le KMT veut réinvestir dans les médias Lire l’article en cliquant sur le lien suivant.
🤝 Programme d’affiliation 🤝
📌 Certains liens de cet article, ainsi que certaines images, renvoient vers des liens sponsorisés, permettant à Insidetaiwan.net de toucher une commission en cas d’achat, sans aucun coût supplémentaire pour vous. 💰 Cela nous aide à financer le magazine et à continuer à vous offrir un contenu indépendant et de qualité. 📖✨
💞 Soutenez-nous 💞
- ⏯ Nous soutenir #financièrement
- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters
- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux
- ⏯ Devenir #partenaire
- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu
- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)
Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.