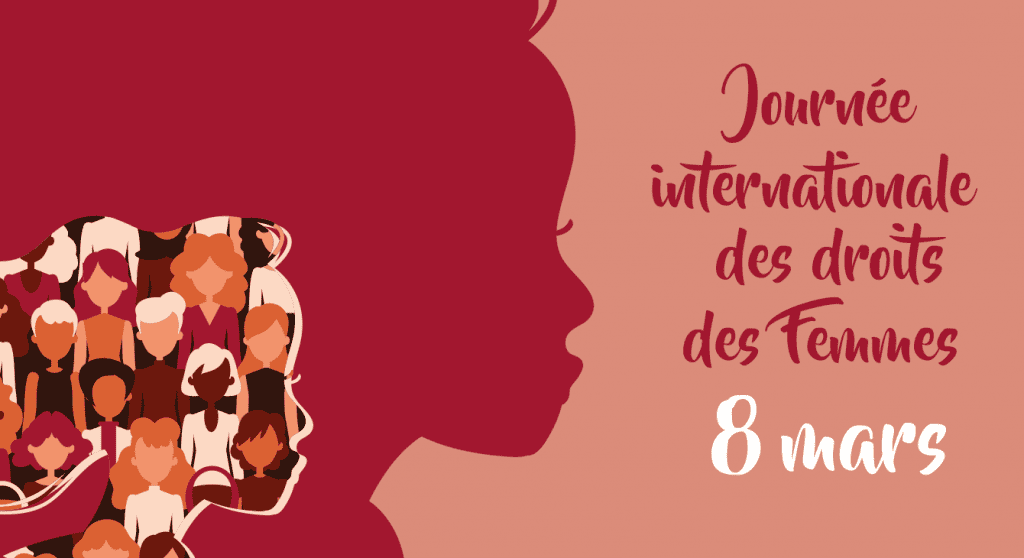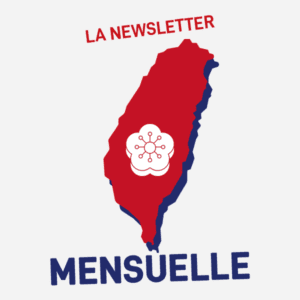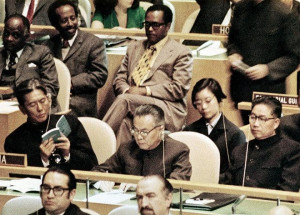En ce 8 Mars, il est essentiel de rappeler que la violence à l’égard des femmes reste une réalité alarmante à travers le monde. Près d’une femme sur trois subit au cours de sa vie des violences physiques ou sexuelles, avec des conséquences profondes sur sa santé mentale, physique et sociale. Les féminicides, les violences domestiques et les abus en ligne continuent d’affecter des millions de femmes et de filles, souvent dans l’indifférence ou le silence. Pourtant, les avancées législatives et les efforts de sensibilisation demeurent insuffisants face à l’ampleur du problème. Voici un état des lieux de l’ONU WOMEN sur les violences faites aux femmes dans le monde.
La prévalence de la violence à l’égard des femmes et des filles
La violence contre les femmes et les filles reste un problème majeur à l’échelle mondiale. On estime que 736 millions de femmes, soit près d’une sur trois, ont subi au moins une fois dans leur vie des violences physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire intime ou d’une autre personne. Ce chiffre, qui concerne 30 % des femmes âgées de 15 ans et plus, ne prend pas en compte le harcèlement sexuel. Les conséquences sont nombreuses : un risque accru de dépression, troubles anxieux, grossesses non désirées, infections sexuellement transmissibles et VIH, ainsi que des effets durables sur la santé.
La majorité des violences envers les femmes sont perpétrées par un partenaire intime, actuel ou passé. On estime que plus de 640 millions de femmes de 15 ans et plus, soit 26 % de cette tranche d’âge, ont subi des violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Ces violences ont des répercussions profondes sur leur bien-être physique, mental et social.
Les féminicides : une réalité alarmante
En 2023, environ 51 100 femmes et filles ont été tuées dans le monde par leur partenaire intime ou un membre de leur famille, soit 140 victimes par jour au sein de leur propre foyer.
Alors que 60 % des féminicides sont perpétrés par un conjoint ou un proche, seuls 12 % des homicides dans le monde ont lieu dans la sphère privée. Ces chiffres soulignent l’ampleur de la violence domestique et la vulnérabilité particulière des femmes et des filles face aux violences commises au sein du foyer.
Les facteurs de risque de la violence à l’égard des femmes et des filles
Les femmes confrontées à plusieurs formes de discrimination sont plus exposées à la violence et en subissent davantage les conséquences.
Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables face aux violences des partenaires intimes. À 19 ans, près d’une adolescente sur quatre (24 %) ayant été en couple a déjà subi des violences physiques, sexuelles ou psychologiques de la part de son partenaire.
Une analyse menée entre 2016 et 2019 dans cinq pays de la CARICOM (Grenade, Guyana, Jamaïque, Suriname et Trinité-et-Tobago) révèle que les femmes de 15 à 64 ans vivant avec des hommes adoptant des attitudes dominantes et inégalitaires étaient plus susceptibles d’avoir été victimes de violences conjugales. Les comportements visant à contrôler le corps, l’autonomie et les relations sociales des femmes sont également fortement liés à un risque accru de violences domestiques.
Les femmes en situation de handicap sont plus exposées aux violences conjugales que celles sans handicap. Une étude menée dans l’Union européenne a confirmé un lien direct entre le handicap et le risque accru de violence, particulièrement chez celles vivant avec de faibles revenus.
Les crises climatiques, sanitaires et humanitaires aggravent la violence contre les femmes et les filles
Les crises multiples, qu’elles soient économiques, environnementales ou liées aux conflits, accentuent les violences basées sur le genre. Les femmes les plus marginalisées sont particulièrement exposées, subissant des formes de discriminations multiples et disproportionnées.
Le changement climatique et la dégradation de l’environnement augmentent les risques de violences contre les femmes et les filles, notamment en raison des déplacements forcés, de la raréfaction des ressources et de l’insécurité alimentaire.
- 80 % des personnes déplacées par le changement climatique sont des femmes.
- Après l’ouragan Katrina en 2005, le taux de viols parmi les femmes déplacées a été six fois supérieur à la moyenne annuelle du Mississippi.
- En Nouvelle-Zélande, la police a signalé une hausse de 53 % des violences domestiques après le tremblement de terre de Canterbury.
- En Éthiopie, le nombre de mariages précoces a augmenté, des familles échangeant leurs filles contre du bétail pour survivre à la sécheresse.
- Au Népal, la traite des êtres humains est passée de 3 000 – 5 000 personnes par an dans les années 1990 à 12 000 – 20 000 après le séisme de 2015.
Les contextes de guerre, de déplacement et de catastrophes exposent davantage les femmes aux violences.
- 70 % des femmes dans les contextes humanitaires subissent des violences basées sur le genre, contre 35 % en moyenne mondiale.
- Le mariage forcé d’enfants est plus fréquent dans les zones de conflit, avec un taux supérieur de 4 points de pourcentage.
- En Afghanistan (juillet 2024), 64 % des femmes déclarent ne pas se sentir en sécurité lorsqu’elles sortent seules, contre 2 % des hommes.
- 8 % des femmes afghanes interrogées affirment connaître au moins une femme ou une fille ayant tenté de se suicider au cours des trois dernières années.
- En Haïti, 8 % des femmes vivant dans des camps ont dû recourir à la prostitution pour survivre, et 20,6 % affirment connaître au moins une autre femme ayant vécu la même situation.
- En Colombie et au Libéria, les femmes déplacées courent 40 % à 55 % plus de risques de subir des violences conjugales que celles qui ne l’ont pas été.
La violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles
À l’échelle mondiale, 6 % des femmes déclarent avoir été victimes de violences sexuelles perpétrées par une personne autre que leur mari ou leur partenaire. Toutefois, la prévalence réelle de ces violences est probablement bien plus élevée, en raison de la stigmatisation qui entoure ce type d’agression et dissuade de nombreuses victimes de témoigner. Des estimations pencheraient plutôt pour plus de 25% des femmes et des filles dans le monde, seraient en réalité victimes de violences sexuelles.
Chaque année, 15 millions d’adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont forcées d’avoir des rapports sexuels. Dans la majorité des pays, ce sont les jeunes filles qui sont les plus exposées aux violences sexuelles de la part d’un partenaire actuel ou passé (mari, conjoint, petit ami). Malgré la gravité de ces agressions, les données de 30 pays révèlent que seulement 1 % des victimes se tournent vers des services d’aide professionnelle.
La traite des êtres humains et l’exploitation des femmes
En 2020, sur 10 victimes de traite des êtres humains recensées dans le monde, quatre étaient des femmes adultes et deux étaient des filles.
La majorité des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle sont des femmes, représentant 91 % des cas détectés. Les données issues des affaires judiciaires révèlent que les femmes victimes subissent des violences physiques ou extrêmes de la part des trafiquants trois fois plus souvent que les hommes.
La violence à l’égard des filles
La proportion de jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans ayant été mariées avant 18 ans a diminué de 19 % au niveau mondial, passant de près d’une sur quatre en 2010 à une sur cinq en 2022. Toutefois, pour éradiquer le mariage des enfants d’ici 2030, le rythme des progrès devrait être multiplié par 20. Sans avancée significative, 9 millions de filles risquent encore d’être mariées avant leur majorité d’ici 2030, avec un impact disproportionné sur les filles issues des communautés les plus pauvres et marginalisées.
Dans le monde, un élève sur trois âgé de 11 à 15 ans a été victime de persécutions ou de harcèlement scolaire au cours du mois précédent, les filles et les garçons étant touchés de manière égalitaire. Toutefois, si les garçons sont davantage confrontés aux brimades physiques, les filles sont plus exposées au harcèlement psychologique. Elles déclarent plus souvent être moquées pour leur apparence physique (visage ou corps) par rapport aux garçons.
Les mutilations génitales féminines : une pratique encore répandue
Les mutilations génitales féminines (MGF) restent une pratique profondément enracinée, affectant des millions de femmes et de filles à travers le monde. Malgré les efforts internationaux pour les éliminer, elles continuent de représenter une menace grave pour la santé, une violation des droits fondamentaux et un facteur de perpétuation des inégalités de genre, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient.
Aujourd’hui, au moins 230 millions de femmes et de filles âgées de 15 à 49 ans ont subi une excision, soit une hausse de 15 % en huit ans, ce qui représente 30 millions de victimes supplémentaires.
En Afrique subsaharienne, une femme ou une fille sur quatre a été mutilée, bien que la prévalence varie considérablement d’un pays à l’autre. Dans certains pays, les MGF sont quasi universelles, touchant plus de 90 % des filles et des femmes, tandis que dans d’autres, comme le Cameroun et l’Ouganda, elles concernent moins de 1 % de la population féminine.
La violence en ligne à l’égard des femmes et des filles
L’essor des technologies numériques a facilité de nouvelles formes de violence basée sur le genre, touchant un grand nombre de femmes à travers le monde.
- Dans l’Union européenne, une femme sur dix a été victime de cyberharcèlement depuis l’âge de 15 ans, notamment par l’envoi de messages sexuellement explicites non sollicités ou par des avances déplacées sur les réseaux sociaux.
- Dans les États arabes, une étude régionale révèle que 60 % des utilisatrices d’Internet ont subi des violences en ligne au cours de l’année écoulée.
- Dans les Balkans occidentaux et en Europe de l’Est, plus de la moitié des femmes présentes en ligne ont été confrontées à une forme de violence facilitée par la technologie au cours de leur vie.
- En Ouganda, en 2021, 49 % des femmes déclaraient avoir été victimes de harcèlement en ligne à un moment donné.
- En Corée du Sud, une enquête menée en 2016 par la Commission nationale des droits humains a révélé que 85 % des femmes ont été la cible de discours de haine en ligne.
Ces chiffres mettent en évidence l’ampleur du cyberharcèlement et des violences numériques, qui constituent un défi croissant pour la protection des femmes et des filles.
La violence à l’égard des femmes dans la vie publique
Les femmes engagées dans la vie publique, notamment les parlementaires et les journalistes, sont confrontées à des niveaux élevés de violence psychologique, de harcèlement et de menaces, souvent liés à leur genre. Ces attaques ne compromettent pas seulement leur sécurité personnelle, mais entravent également l’égalité des sexes et la participation démocratique.
Violence contre les femmes parlementaires
Dans cinq régions du monde, 82 % des femmes élues déclarent avoir subi une forme de violence psychologique au cours de leur mandat. Cela inclut :
- Des commentaires, gestes ou images à caractère sexiste et des références sexuelles humiliantes.
- Des menaces et intimidations, souvent collectives.
- Près de la moitié (44 %) ont reçu des menaces de mort, de viol, d’agression ou d’enlèvement, visant elles-mêmes ou leur famille.
- 65 % des élues ont été la cible de remarques sexistes, principalement de la part de collègues masculins.
- Les réseaux sociaux sont cités comme le principal vecteur de violences.
Violence contre les femmes journalistes
Une enquête mondiale révèle que :
- 73 % des femmes journalistes ont subi des violences en ligne.
- 20 % ont été attaquées ou agressées physiquement, en lien avec le harcèlement numérique dont elles avaient été victimes.
- Les sujets les plus susceptibles d’exposer les journalistes aux attaques sont :
- Les questions de genre (49 %).
- La politique et les élections (44 %).
- Les droits humains et les politiques sociales (31 %).
Ces formes de violences ciblées constituent un obstacle majeur à la liberté d’expression et à la participation des femmes dans la sphère publique.
Le signalement des violences faites aux femmes
Moins de 40 % des femmes victimes de violences cherchent de l’aide, sous une forme ou une autre. Dans la plupart des pays disposant de données sur le sujet, celles qui demandent du soutien se tournent principalement vers leur famille ou leurs amis, tandis que très peu sollicitent les institutions officielles, comme la police ou les services de santé.
Moins de 10 % des femmes qui cherchent de l’aide déposent une plainte auprès des autorités.
Les lois sur la violence à l’égard des femmes et des filles
En 2022, seulement 14 % des femmes et des filles dans le monde, soit environ 557 millions de personnes, vivaient dans des pays disposant de protections juridiques solides garantissant leurs droits fondamentaux.
L’impact de la législation sur les violences domestiques
- Les pays ayant des lois contre les violences domestiques enregistrent des taux plus faibles de violence conjugale (9,5 % contre 16,1 % dans les pays sans législation).
- 151 pays disposent de lois sur le harcèlement sexuel au travail, mais seulement 39 en ont pour le harcèlement dans les espaces publics.
- Parmi les 165 pays ayant légiféré contre les violences domestiques, seulement 104 ont des lois complètes couvrant toutes les formes de violences.
Les avancées législatives en 2023
- Le Lesotho, le Togo et l’Ouzbékistan ont adopté des lois contre les violences domestiques.
- L’Arménie, la Guinée équatoriale, la Jordanie, la Moldavie et le Suriname ont mis en place des lois contre le harcèlement sexuel au travail.
Des lacunes persistantes dans la législation
- Plus de 60 % des pays ne disposent toujours pas de lois sur le viol basées sur le principe du consentement.
- Moins de la moitié des femmes dans le monde sont protégées contre le harcèlement en ligne.
- 139 pays ne disposent pas de lois adéquates interdisant le mariage des enfants.
Malgré des avancées, la protection juridique des femmes et des filles reste incomplète, laissant de nombreuses victimes sans recours légal efficace.
Financement pour mettre fin aux violences contre les femmes et les filles
En 2023, seuls 27 pays disposent d’un système complet de suivi et d’allocation budgétaire dédié à l’égalité des genres et à l’autonomisation des femmes.
- Malgré une hausse globale de l’Aide publique au développement (APD) ces cinq dernières années, les fonds alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes ont diminué de 13 % entre 2018-2019 et 2020-2021.
- 99 % de l’APD liée au genre ne parvient pas aux organisations locales de défense des droits des femmes ni aux mouvements féministes.
- Seuls 5 % du financement total des pays membres de l’OCDE destiné à mettre fin aux violences contre les femmes et les filles est attribué aux organisations de la société civile.
Ces chiffres soulignent un manque de ressources pour soutenir efficacement les initiatives locales et les organisations engagées dans la protection des femmes.
Le coût économique de la violence à l’égard des femmes et des filles
La violence contre les femmes a des répercussions économiques majeures pour les victimes, l’État et la société dans son ensemble. Ces coûts peuvent être directs (dépenses médicales, salaires des professionnels travaillant dans des centres d’accueil) ou indirects (perte de revenus, baisse de productivité).
- Au Vietnam, les dépenses personnelles et les pertes de revenus liées à la violence représentent 1,41 % du PIB. Les femmes victimes de violences gagnent en moyenne 35 % de moins que celles qui ne le sont pas, ce qui pèse lourdement sur l’économie nationale.
- En Égypte, la violence conjugale entraîne chaque année 500 000 journées de travail perdues et 14 millions de dollars de dépenses de santé, ne permettant d’aider qu’un quart des survivantes.
- Au Maroc, les violences physiques et/ou sexuelles envers les femmes coûtent environ 2,85 milliards de dirhams (soit 308 millions de dollars) par an.
- En Union européenne, le coût annuel des violences basées sur le genre est estimé à 366 milliards d’euros, dont 79 % concernent spécifiquement la violence contre les femmes, soit 289 milliards d’euros.
💞 Soutenez-nous 💞
- ⏯ Nous soutenir #financièrement
- ⏯ S’inscrire à nos #Newsletters
- ⏯ Nous suivre sur nos #réseaux sociaux
- ⏯ Devenir #partenaire
- ⏯ Proposer des #articles et du #contenu
- ⏯ Découvrir nos offres #professionnelles (Publicités, Conseils…)
Pour découvrir nos offres rendez-vous sur la page dédiée (Nous soutenir) ou contactez-nous pour collaborer avec nous.